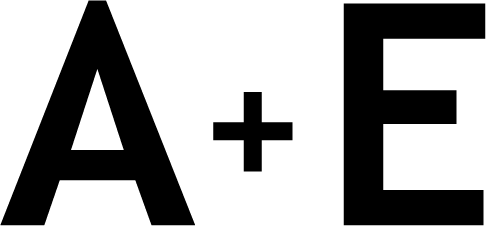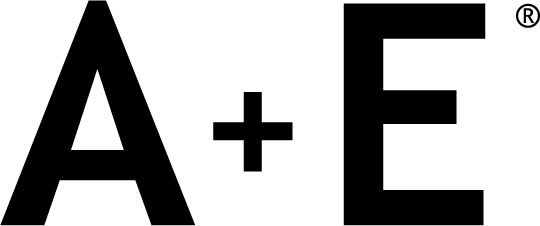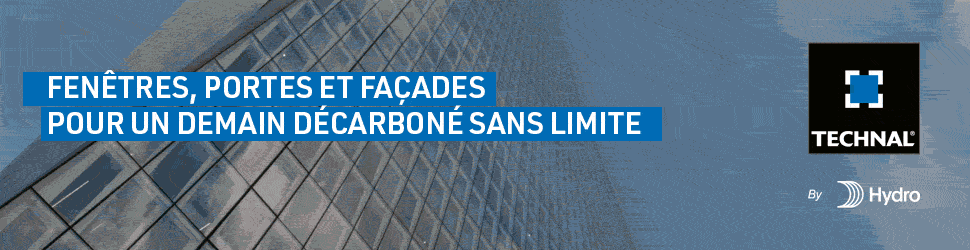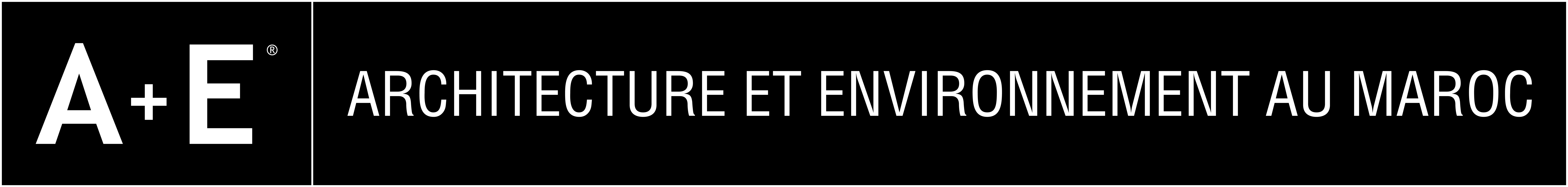Figure emblématique du paysage culturel marocain, Souad Belkeziz, présidente de l’association Turāth Marrakech, incarne une vision singulière du patrimoine, où préservation rime avec spiritualité urbaine. Portée par une passion profonde pour la médina, elle œuvre sans relâche à sauvegarder la Ǫoubba almoravide et d’autres lieux emblématiques, révélant les délicats entrelacs qui unissent mémoire collective, architecture vernaculaire, culture de l’eau et dimension spirituelle. À Marrakech, son engagement dépasse la simple restauration : il s’agit, avant tout, de redonner sens et souffle à un héritage vivant.
A+E // Ǫu’est-ce qui vous a poussé à fonder Turāth Marrakech ?
Souad Belkeziz : Ce qui m’a poussé, avec Patrik Mana’ch et Faten Safieddine, tous deux passionnés et fervents amoureux du patrimoine, à fonder Turāth Marrakech, est une conviction profonde que notre patrimoine architectural et culturel mérite d’être préservé, valorisé et transmis aux générations futures de manière vivante et accessible. En tant qu’architecte passionnée par l’histoire de Marrakech, j’ai ressenti un besoin impérieux de créer une plateforme qui permette non seulement de protéger ce patrimoine unique, mais aussi de l’étudier afin de percer les mystères enfouis dans le temps. Nous avons le devoir de mieux connaître notre héritage pour pouvoir le transmettre plus efficacement aux générations à venir. Aujourd’hui, Marrakech doit interroger son histoire, encore trop peu explorée, tout en sensibilisant le public à l’importance de sa préservation.
C’est dans ce cadre que j’ai eu l’honneur de publier trois livres sur le patrimoine de la ville de Marrakech : « Le Miracle de l’Eau : Marrakech », « Cité Jardin Idéale, Palais » et « Forteresses d’El Mansour Eddahbi » (écrits respectivement en arabe et en français), ainsi que « L’Énigme de la Qoubba Almoravide ». Mon quatrième livre, coécrit avec Patrik Mana’ch, porte sur la cartographie de Marrakech. Ces travaux visent à explorer, documenter et transmettre un patrimoine à la fois riche et fascinant, dans l’espoir de susciter une prise de conscience collective et de donner aux générations futures les clés pour comprendre et préserver leur héritage.
Avec plusieurs membres très passionnés, nous avons voulu que l’association soit un pont entre les générations, où les jeunes puissent prendre conscience de la richesse historique de leur ville et s’engager activement dans sa protection. À travers Turāth, nous souhaitons tous que la ville de Marrakech, avec ses joyaux architecturaux, devienne un modèle de préservation, de réconciliation avec le passé et d’innovation contemporaine dans le respect de son histoire.
Fonder Turāth Marrakech a été une manière de répondre à un besoin : celui de concilier préservation, éducation, innovation et inclusion pour faire du patrimoine un bien commun vivant.
A+E // La Ǫoubba almoravide, que vous décrivez comme “énigmatique”, cristallise un triple lien entre l’eau, l’architecture et le sacré. Ǫue révèle-t-elle, selon vous, de notre rapport à la ville, au rituel, et à la transmission ?
S. B. : La Qoubba almoravide est un lieu empreint de mystère, non seulement par sa fascinante architecture, mais aussi par les significations profondes qu’elle renferme. Elle incarne un triple lien entre l’eau, l’architecture et le sacré, qui interroge notre relation à la ville, aux rituels et à la transmission des savoirs. La Qoubba almoravide devient ainsi un puissant symbole de l’eau, qui, à Marrakech, ne se limite pas à la seule dimension sacrée telle qu’elle est définie dans le livre sacré, mais s’élargit pour devenir un mémorial de l’exploit incroyable consistant à amener l’eau depuis des régions lointaines, parcourant des kilomètres, et à la distribuer gratuitement grâce à un système hydraulique ancestral d’une grande perfection. En fait, la Qoubba almoravide est l’aboutissement final de cette eau sacrée qui deviendra, dans plusieurs pays arabo-musulmans, un élément fondamental et central de la grande mosquée, toujours une « gardienne de l’eau ».
La majorité des auteurs, principalement occidentaux, n’ont pas saisi toute la portée de cette valeur sacrée liée à l’eau, ni l’aspect rituel, mémoriel et symbolique qui rapproche la Qoubba almoravide d’autres constructions commémorant l’eau, telles que la Qoubba de Zemzem au Masjid al-Haram (aujourd’hui disparue), ou encore celle à l’intérieur de la mosquée du Prophète, où des symboles similaires, chargés de mysticisme, sont présents. La Qoubba almoravide comporte, tout en haut de son dôme, une immense étoile à sept branches, visible uniquement depuis le ciel. Comment interpréter ce symbolisme et ce sacré qui relie le ciel et la terre, cette étoile à sept branches, très rare dans le vocabulaire architectural de l’art islamique ?
Une autre question intrigante est celle des Almohades, qui ont détruit la majeure partie de la mosquée almoravide primitive. Pourquoi n’ont-ils pas détruit cette Qoubba, et pourquoi ont-ils choisi de marteler toutes les inscriptions relatives à la dynastie almoravide, tout en préservant cet édifice architectural dans toute sa splendeur ? Qu’y avait-il de si sacré dans cette Qoubba pour que les Almohades, qui ont abattu tous les symboles de la dynastie almoravide, aient décidé de maintenir intact ce monument si significatif ?
L’architecture de la Qoubba almoravide, et en particulier sa coupole composée de huit arcs entrecroisés au-dessus d’une corniche carrée semblant flotter au-dessus du bassin d’eau central, évoque directement le verset coranique : « Et c’est Lui qui a créé les cieux et la terre en six jours, alors que Son Trône était sur l’eau » (Coran, 11,7), un élément qui témoigne de la dimension sacrée inscrite jusque dans la composition même de l’édifice. Les architectes almoravides ont su allier des principes mathématiques et esthétiques pour concevoir un espace à la fois fonctionnel et symbolique. La Qoubba incarne ainsi l’idée que l’architecture ne doit pas seulement répondre à des besoins pratiques, mais aussi refléter l’ordre cosmique et l’unité divine.
Cette vision se manifeste aussi dans la manière dont l’architecture a été pensée pour dialoguer avec l’eau. La Qoubba illustre ainsi notre relation à l’urbanisme et à l’hydraulique comme une quête d’équilibre entre l’ordre humain et le divin. Elle nous rappelle que la ville n’est pas simplement un ensemble de structures utilitaires, mais un organisme vivant où chaque élément doit porter une signification profonde, un but spirituel et symbolique.
La Qoubba almoravide est également un témoin de la transmission des savoirs. En tant qu’espace à la fois architectural et rituel, elle a été un lieu de diffusion de connaissances, notamment par le biais de son architecture innovante. Plusieurs éléments architecturaux emblématiques ont vu le jour dans ce bâtiment et deviendront des références pour l’architecture maghrébine, tels que l’arc en ogive, les arcs entrecroisés porteurs et non seulement décoratifs, la coupole nervurée terminale, les muqarnas, et bien d’autres. De plus, la réintroduction de la brique cuite, utilisant des techniques sophistiquées, apparaît comme une innovation marquante de la Qoubba almoravide. Cette technique sera transmise au fil des siècles aux dynasties suivantes : des Almoravides aux Almohades, Mérinides, Saadiens et Alaouites.
A+E // Ǫuel a été le fil rouge de cette édition des Journées du Patrimoine ? Y a-t-il un thème secret ou invisible qui traverse l’ensemble des parcours proposés cette année ?
S. B. : Le fil conducteur de la 3ᵉ édition des Journées du Patrimoine de Marrakech, organisée par l’association Turāth du 22 au 25 mai 2025, s’est déroulé sous le thème « Marrakech, au fil de l’eau et des jardins ». Un thème qui résonne comme un écho au cœur de la ville ocre, où l’eau, l’architecture et la nature se sont développées ensemble à travers les âges. Si ce thème semble d’abord évident, il s’ouvre en réalité sur des dimensions bien plus subtiles, qui imprègnent chacun des parcours proposés cette année. L’événement invite les participants à plonger au-delà des trésors matériels du patrimoine, pour toucher du doigt les liens invisibles qui unissent les habitants à leur environnement. Ce « fil invisible » se déploie à travers plusieurs facettes, chaque parcours étant une invitation à la découverte de la ville.
Les circuits guidés, tout d’abord, offrent des promenades où l’histoire se dévoile en silence, comme dans le parcours de la Koutoubia ou celui de Riad Al Arouss. Ces chemins révèlent des sites emblématiques où l’eau et les jardins, tels des acteurs discrets mais puissants, dessinent l’histoire et l’architecture de Marrakech. Pour la première fois, des lieux oubliés, comme le pavillon du jardin Moulay Abdeslam, émergeant du cœur d’un hôtel, retrouvent leur lien perdu avec le jardin Moulay Abdeslam. L’association Turāth œuvre ainsi à ressusciter cette mémoire effacée, offrant aux générations futures les clés d’un patrimoine à redécouvrir.
Dans un geste de partage, le consul de France a ouvert les portes de sa résidence, le jardin Moulay Ali, permettant à un large public de s’imprégner de l’essence de ce lieu chargé d’histoire. Ce geste, salué chaleureusement par les Marrakchis, a permis de redécouvrir un jardin aux racines profondes, un lieu où la mémoire s’exprime à nouveau.
À travers la médina, les visiteurs se sont émerveillés devant les arbres remarquables, véritables témoins silencieux de l’histoire, que nous proposons de classer comme patrimoine paysager. Chaque arbre, avec ses racines ancrées dans le sol et ses branches tendues vers le ciel, raconte une histoire. Les guides bénévoles, eux-mêmes touchés par la poésie et la sacralité de ces lieux, ont offert une pièce théâtrale en hommage aux arbres de la médina, une initiative que nous souhaitons aujourd’hui diffuser et célébrer.
Cette année, nous avons voulu resserrer encore les liens avec la population marrakchie, en l’invitant à être actrice de ces découvertes. Grâce à la Fondation Dar Bellarj et à l’implication de Maha El Madi, nous avons offert une formation à un groupe de femmes, les « mamans douées ». Ces femmes, désormais formées à l’histoire de la Qoubba Almoravide, auront la mission précieuse de transmettre ce savoir à leurs enfants et à leur entourage, contribuant ainsi à préserver et à transmettre le patrimoine vivant de Marrakech.
Et parce que la jeunesse est la clé de demain, nous avons voulu offrir aux enfants de notre ville une expérience ludique pour éveiller en eux l’amour du patrimoine. Des jeux créatifs, dont un jeu des sept familles « spécial patrimoine marocain », ont été conçus par les membres de l’association. Ces jeux ont été testés auprès des plus jeunes et seront bientôt largement diffusés, afin que les enfants puissent, à travers le jeu, s’approprier l’histoire de leur ville. C’est en eux que se trouve le futur du patrimoine.
A+E // Votre démarche s’inscrit à la croisée de la conservation et de la création de récits. Comment l’architecture devient-elle, à vos yeux, une médiatrice de la mémoire collective ?
S. B. : L’architecture, à travers des monuments comme la Qoubba Almoravide, devient un véritable médiateur de la mémoire collective en incarnant à la fois un témoin du passé et un point de référence pour l’avenir. Les monuments, par leur forme et leur structure, racontent non seulement l’histoire des dynasties de Marrakech, mais ils portent aussi les traces des savoir-faire ancestraux et des événements marquants qui ont façonné cette ville. À travers leur restauration et leur mise en valeur, ils deviennent le support d’un récit vivant qui traverse les âges.
Chaque détail architectural, chaque inscription et chaque élément de décoration renvoie à des récits oubliés ou méconnus, ouvrant une porte vers une compréhension plus profonde de notre histoire. Ainsi, la Qoubba n’est pas seulement un monument ; elle est une source de transmission de mémoire. Lorsqu’on la traverse, on ressent la présence de ceux qui l’ont conçue et vécue, et, en la préservant, nous nous assurons que ces histoires, ces symboles et cette culture ne se perdent pas, mais qu’ils continuent de nourrir les générations futures.
Ainsi, l’architecture devient un pont entre le passé et l’avenir, une médiatrice qui permet à la mémoire collective de se nourrir du présent pour construire le futur. La Qoubba Almoravide, par exemple, incarne ce lien puissant, tout en devenant un lieu où le public peut se reconnecter à ses racines et redécouvrir la richesse de son héritage.
A+E // Visites en side-car, parcours sensoriels, récits croisés… Vous explorez des formes de médiation culturelle peu conventionnelles. S’agit-il d’inventer une nouvelle pédagogie du patrimoine ?
S. B. : Oui, il s’agit véritablement d’inventer une nouvelle pédagogie du patrimoine, une approche qui se libère des conventions traditionnelles pour mieux épouser les sensibilités contemporaines et la diversité des publics. À travers des formes de médiation culturelle plus immersives et expérientielles, nous redéfinissons la manière dont nous entrons en contact avec l’histoire, l’architecture et les récits du patrimoine. Voici comment ces nouvelles approches transforment la pédagogie patrimoniale :
Lors de la dernière édition, nous avons imaginé un parcours sensoriel inédit au cœur des foundouks, invitant les participants à toucher, écouter les chants des oiseaux emblématiques de Marrakech, tels que le « Tibibt », à inhaler les fragrances envoûtantes des épices, voire à goûter l’espace lui-même. Cette immersion totale dans le patrimoine a éveillé tous les sens, offrant aux visiteurs une expérience plus intime et profonde du lieu. L’enthousiasme suscité a été considérable, touchant directement les émotions et la perception des participants, qui ont pu établir une connexion plus personnelle avec l’espace patrimonial, en ressentant ses énergies et en faisant ressurgir les histoires enfouies.
L’un des grands objectifs de ces formes de médiation est de rendre le patrimoine accessible à un public plus large, y compris à ceux qui, traditionnellement, n’ont pas accès aux formes classiques de transmission (conférences, visites guidées traditionnelles). Cette année, nous avons mis en place des visites guidées pour transmettre les valeurs et la sacralité des arbres remarquables de la médina de Marrakech. Certains sont à proximité d’un saint de Marrakech, d’autres ont toujours été là depuis plus d’un siècle et représentent, tout comme le patrimoine bâti, un pan de notre histoire. Comment sensibiliser le grand public à la nécessité de protéger ce patri- moine végétal ? Et comment sensibiliser également les pouvoirs publics à l’importance de mettre en valeur ce patrimoine en revalorisant l’espace dans lequel il est implanté ?
Cette année, nous avons aussi voulu mettre en place une sensibilisation auprès des femmes des quartiers de la médina et des enfants à travers le jeu, les contes et les chants. Cette forme de médiation est un très bon moyen pour transmettre des valeurs. Mais notre plus grande innovation réside dans l’ouverture d’une nouvelle visite guidée, en de- hors des sentiers battus, permettant de découvrir les grands aménagements hydrauliques ancestraux de Marrakech. Ces visites en moto-taxi à trois places, proposées tout au long de l’année, conduiront les participants à la découverte des khettaras situées dans des parcs emblématiques, des bassins monumentaux et des citernes d’eau. Une grande surprise attend la population marrakchie : nous leur dévoilerons un bassin monumental magnifiquement conservé d’un ancien jardin almoravide, lieu d’une bataille historique où les Almohades furent défaits pour la première fois par les Almoravides. Comme je vous l’ai dit, nous œuvrons sans relâche pour interroger l’histoire et en révéler les réponses cachées !
A+E // On parle souvent de réhabilitation des lieux. Mais comment, dans vos projets, réhabilite-t-on aussi les regards, les usages, les imaginaires liés à ces espaces patrimoniaux ?
S. B. : La réhabilitation des espaces patrimoniaux ne se limite pas à leur restauration matérielle, elle englobe également la réhabilitation des regards, des usages et des imaginaires associés à ces lieux. Dans nos projets, cette démarche vise à inviter les visiteurs, les habitants et les acteurs locaux à voir les sites autrement. Parfois, après des siècles de transformations ou d’abandon, les sites perdent leur signification initiale. L’objectif est donc de raviver leur dimension historique et symbolique, ce qui nécessite des recherches approfondies sur chaque monument. Prenons l’exemple du Palais El Badii. Pour mieux faire comprendre l’importance de ce patrimoine emblématique, nous avons mis en place des équipes de guides bénévoles formés grâce à des recherches approfondies menées par nos experts. Ces guides racontent l’histoire du palais sous des angles différents, adaptés aux enfants comme aux adultes, en intégrant les récits d’El Fashtali, le vizir qui a longtemps évoqué les palais et forteresses d’El Mansour Eddahbi.
Nous avons également créé des livrets pour enfants, qui seront diffusés tout au long de l’année pour toucher un public plus large. Récemment, nous avons signé un partenariat avec l’Association des Guides de Marrakech pour collaborer à la valorisation de notre patrimoine. Concernant la Qoubba Almoravide, il est fréquent que les touristes ne s’arrêtent qu’à une vue extérieure, sous-estimant l’histoire riche que cache ce site. Notre rôle, en tant qu’association, est de réhabiliter ce regard, de montrer aux visiteurs l’importance de ces monuments pour mieux les comprendre et transmettre leur histoire.
Il en va de même pour des sites comme le Qsar El Hjar, construit dès la fondation de Marrakech, et qui, malheureusement, est souvent négligé. Si aucune action de sensibilisation n’est entreprise, ces vestiges risquent de disparaître de la mémoire collective. Pour la première fois, l’association Turath a intégré ce site dans ses circuits de visite, et la population locale a été admirative des récits détaillés fournis par nos experts, qui avaient mené une documentation approfondie.
Ainsi, réhabiliter le regard porté sur ces espaces patrimoniaux est essentiel. Une fois ces regards rétablis, la transmission du patrimoine devient bien plus efficace. L’un des défis majeurs de la réhabilitation d’un site patrimonial est aussi de lui redonner une fonction sociale et de le réintégrer dans le tissu urbain vivant. Trop souvent, les monuments sont perçus comme des objets statiques, sans usage. La réhabilitation doit, au contraire, permettre de réactiver ces espaces, de les adapter aux besoins contemporains tout en préservant leur identité. Aujourd’hui, il semble que le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication soit de plus en plus ouvert à cette approche, qui a déjà montré son efficacité à Marrakech.
A+E // L’inclusion citoyenne est au cœur de vos actions. Selon vous, en quoi le patrimoine peut-il redevenir un “bien commun” vivant, et non une vitrine figée ?
S. B. : C’est une question cruciale, car trop souvent, derrière les discours sur la valorisation du patri- moine, se cachent des dynamiques qui peuvent conduire à l’exclusion. Ce que nous observons dans de nombreuses médinas marocaines, et Marrakech n’y échappe pas, c’est un processus de gentrification insidieux. Dès que la valeur d’un quartier grimpe, les habitants historiques, les petits métiers, les commerces de proximité sont peu à peu poussés dehors. On assiste à une transformation profonde du tissu social : des échoppes traditionnelles deviennent des boutiques touristiques, des écoles ferment faute d’enfants, et les anciens résidents sont relégués à la périphérie, chassés par la spéculation foncière.
Pour que le patrimoine reste un bien commun vivant, il faut dès le départ poser une intention claire : le maintien de la population locale comme objectif premier de toute réhabilitation. Réhabiliter un lieu, ce n’est pas seulement restaurer ses murs. C’est aussi restaurer la vie quotidienne, les usages populaires, les gestes du quotidien, les voix de la mémoire. Cela suppose une approche sensible, profondément ancrée dans le territoire, construite avec et pour les habitants.
À Marrakech, nous avons vu que cela peut fonctionner. Prenons l’exemple des foundouks artisanaux réhabilités dans la médina : au lieu d’être transformés en galeries ou cafés tendance, ils ont été restaurés en étroite concertation avec les artisans. Ce choix a permis de maintenir les savoir-faire sur place, de préserver la fonction économique originelle et même de créer des dynamiques d’insertion professionnelle pour les jeunes. Ces lieux continuent à battre au rythme de la ville.
Autre exemple emblématique : la réhabilitation de Dar Bellarj, près de la mosquée Ben Youssef. L’ancienne fondation a été transformée en centre culturel vivant, ouvert aux habitants, aux femmes du quartier, aux artistes, aux jeunes, avec des ateliers de transmission, des expositions, des contes. Le patrimoine y devient un lieu d’expression et de lien social, non un décor figé pour visiteurs de passage. Mais il faut aller encore plus loin : penser des mécanismes de gouvernance partagée autour des espaces patrimoniaux. Il est temps d’oser des outils juridiques innovants comme le bail solidaire patrimonial, qui permettrait à une famille ou un artisan de rester dans un lieu réhabilité, en échange d’un engagement à le maintenir en vie et à transmettre ses savoirs.
Enfin, nous devons redonner au patrimoine sa dimension émotionnelle et symbolique. Cela passe par des médiations inclusives : ateliers de mémoire, parcours sensoriels, nuitées culturelles, narrations portées par les habitants eux-mêmes. Le patrimoine doit être raconté par ceux qui le vivent, dans leur langue, avec leurs mots.
En somme, pour qu’un site patrimonial ne devienne pas une vitrine figée, il faut en faire un espace partagé, habité, raconté. Un lieu de transmission, de création, d’ancrage. Le patrimoine est vivant quand il continue à faire société.
A+E // La médina de Marrakech, lieu de friction et de fascination, reste en perpétuelle tension entre préservation et mutation. Ǫuelle vision portez-vous sur son avenir architectural et social ?
S. B. : La médina de Marrakech, comme tant d’autres médinas au Maroc, se trouve à un carrefour délicat entre préservation et transformation. J’ai eu l’opportunité de mener plusieurs projets de restauration dans ces quartiers historiques, et il est souvent surprenant de voir, même pendant ces interventions, des changements radicaux opérés par le phénomène de gentrification. Ce processus de valorisation des espaces, tout en étant positif en termes de requalification, entraîne parfois des conséquences sociales difficiles. La gentrification, bien qu’elle valorise l’espace, augmente les valeurs foncières et chasse souvent les populations les moins favorisées, notamment les artisans, au profit de nouveaux commerces.
Ce phénomène peut priver la médina de son âme et de son authenticité. Ces opérations apportent une grande valeur ajoutée, mais elles doivent être accompagnées d’un soutien social solide, qui préserve l’artisanat et évite de transformer les quartiers historiques en musées, comme cela s’est produit dans certains secteurs. Par exemple, après la rénovation du Mellah de Marrakech, de nombreux ferblantiers ont été contraints de quitter la médina, déplaçant leur activité vers les périphéries. Dans d’autres quartiers, des métiers comme ceux des teinturiers ont perdu leur place centrale dans le tissu urbain, effaçant des ambiances et des couleurs intrinsèques à l’identité de la ville.
L’association Turāth a d’ailleurs soulevé cette problématique lors de l’édition précédente des Journées du Patrimoine, en produisant un film documentaire pour sensibiliser le public à l’importance de concilier restauration et préservation des usages traditionnels. Si la mise en valeur du patrimoine est essentielle, elle doit absolument s’accompagner de mesures sociales pour que la transformation ne devienne pas une menace pour les communautés traditionnelles. Il s’agit de garantir que la médina reste un espace vivant, où l’histoire, l’artisanat et les usages contemporains peuvent coexister harmonieusement.
La médina de Marrakech, avec ses tensions entre préservation et mutation, doit adopter une vision flexible et inclusive pour son avenir. En alliant respect du patrimoine, innovation architecturale et engagement social, il est possible de créer un modèle de développement qui maintient la vitalité de ce lieu tout en le protégeant pour les générations futures. La médina doit rester un bien commun vivant, un lieu où le passé, le présent et l’avenir se rencontrent dans une harmonie dynamique.
Enfin, l’événement a bénéficié du soutien précieux de plusieurs institutions publiques marocaines, confirmant ainsi l’importance accordée à la valorisation et à la transmission du patrimoine. Parmi ces partenaires figurent le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la Wilaya de Marrakech-Safi, ainsi que la Région Marrakech-Safi. La Commune de Marrakech et le Conseil Régional du Tourisme (CRT) Marrakech ont également accompagné activement l’organisation, aux côtés de la Fondation Jardin Majorelle, renforçant ainsi la portée culturelle et touristique de cette édition.
Plusieurs autres partenaires ont contribué à la réussite de cette troisième édition, dont le Centre National Mohammed VI pour les Handicapés, l’Institut français, le Consulat de France à Marrakech, Open Minds de l’UM6P, la Chorale Tourath de l’UM6P, High-tech Event, Visit Marrakech, l’Association régionale des guides de tourisme, la Fondation Montresso, Emerging Business Factory, Insiders Marrakech, Dar Bellarj, Enfance et Découvertes Maroc, Luxavia, Vias, Menara Prefa, Pépinière Hibiscus, UpcycleMo, 28, rue Products, Potteryzin, le JAAL Riad Resort, Les Deux Tours, La Villa des Orangers, Le Pestana, M Avenue, Meydene, Le Douar, le restaurant Bagatelle.
A+E // Enfin, s’il fallait transmettre à la prochaine génération une seule chose à travers Turāth, une seule phrase, un geste ou une conviction : quelle serait-elle ?
S. B. : Une seule phrase qui est devenue notre devise à Turath : « Réveillez les silences du passé, pour que le présent éclaire l’avenir. ». Une conviction : « Ensemble pour le patrimoine » !
TURĀTH MARRAKECH EN QUELQUES CHIFFRES
| Nombre de jours de visites et d’évènements | 4 jours (du 22 au 25 mai 2025) |
| Nombre de participants en 2025 | Plus de 20 000 visiteurs |
| Nombre de parcours thématiques | 4 parcours |
| Nombre de guides bénévoles | 200 bénévoles formés |
| Nombre total d’intervenants (artistes, artisans, conférenciers…) | Environ 300 personnes mobilisées |
| Nombre de langues proposées | Arabe, français, anglais, parfois espagnol et amazigh |
| Nombre de sites patrimoniaux ouverts | Multiplié par quatre par rapport aux éditions précédentes |
| Accès | Gratuit, avec inscriptions sur 4 sites principaux |
| Partenaires mobilisés | +40 institutions, associations et entreprises locales |
Propos recueillis par Yasmina Hamdi