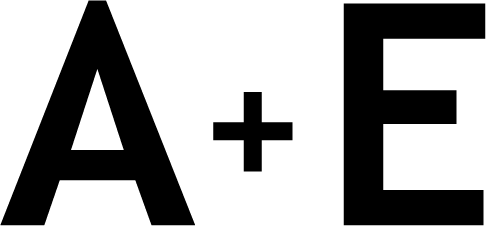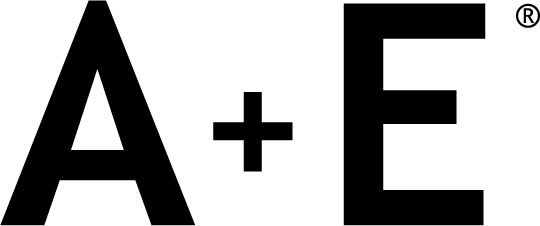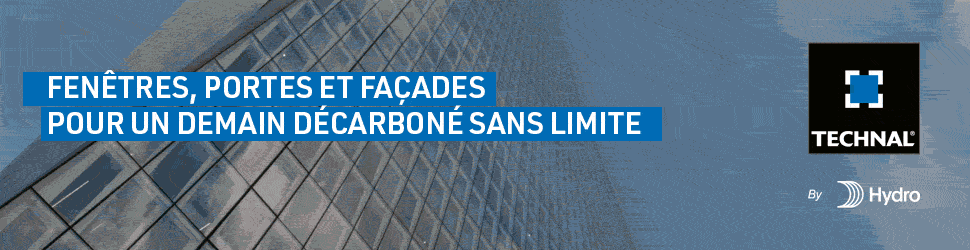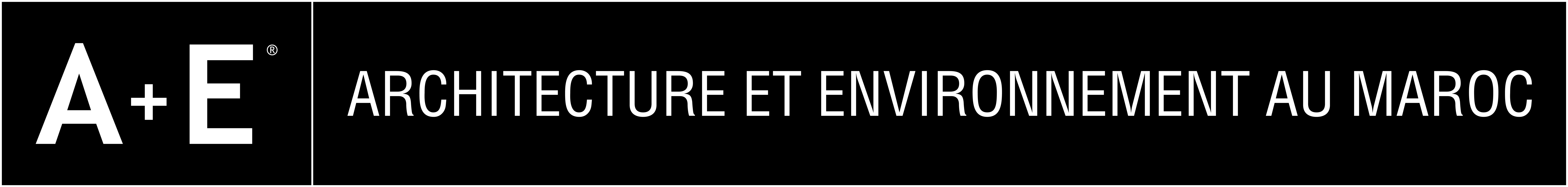Au moment où le Maroc repense ses politiques d’aménagement et de développement territorial, le Conseil National de l’Ordre des Architectes (CNOA) met en lumière un acteur souvent méconnu mais essentiel : l’architecte du secteur public. Réunis à Kénitra, les membres de la Commission du Secteur Public ont engagé une réflexion de fond sur le rôle stratégique de ces architectes au sein de l’administration, à la croisée des politiques urbaines, du patrimoine et du logement.
Sous la présidence de Chakib Benabdellah, cette rencontre amorce un véritable tournant ordinal : celui de la reconnaissance statutaire, de la montée en compétences et de la visibilisation d’un métier pivot dans la gouvernance des territoires. Car loin d’être de simples exécutants, les architectes du secteur publics sont des concepteurs de politiques spatiales, garants de la cohérence entre vision, réglementation et qualité du cadre bâti.
Leur mission est de traduire l’ambition nationale en projets concrets, articuler l’expertise publique à l’innovation privée, et inscrire la culture architecturale au cœur du développement durable des territoires marocains.
Un enjeu majeur pour l’avenir d’une architecture d’intérêt général, à la fois équitable, exigeante et enracinée dans le réel.
A+E // Quels sont, selon vous, les principaux leviers pour mieux valoriser le rôle de l’architecte au sein de l’administration publique ?
Chakib Benabdellah : Plusieurs leviers prioritaires ont été identifiés lors de la réunion de la Commission Public du 13 septembre 2025 à Kénitra :
- Vers une reconnaissance statutaire et fonctionnelle
La valorisation de l’architecte public passe par une clarification et une consolidation de son statut. Ses missions et ses responsabilités doivent traduire la spécificité de sa fonction intellectuelle et stratégique. L’administration gagnerait à reconnaître davantage l’architecte comme expert transversal, capable d’articuler tant les enjeux des territoires, que du patrimoine bâti, et d’un cadre de vie durable. Une sous-commission “Cadre réglementaire et statut”, instituée lors de cette réunion, est chargée d’élaborer des propositions concrètes pour actualiser et réadapter le statut interministériel commun des architectes et ingénieurs d’état et à leurs aspirations.
- La montée en compétences comme levier de valorisation
La transition écologique, l’adaptation climatique, l’inclusion territoriale, le patrimoine bâti, la digitalisation sont autant de défis contemporains qui exigent de nouvelles compétences. La formation continue et la création de réseaux d’échange entre architectes publics permettraient de renforcer leur rôle de conseil éclairé et d’innovation dans les politiques publiques.
- Donner visibilité à l’action de l’architecte public
Il est temps de rendre visible l’apport des architectes du secteur public. Par leurs avis, leurs études et leur accompagnement, ils participent à l’amélioration de la qualité des projets et du cadre bâti national. Valoriser leurs contributions dans les publications institutionnelles, les expositions ou les distinctions professionnelles renforcerait leur légitimité et la reconnaissance de leur mission d’intérêt général.
A+E // Le Discours Royal du 29 juillet 2025 met en avant une nouvelle génération de programmes de développement territorial intégré : quelle contribution spécifique attendez-vous des architectes du secteur public dans ce cadre ?
C.B. : Dans le sillage du Discours Royal du 29 juillet 2025, qui appelle à un développement territorial équitable et intégré, le CNOA a la conviction que l’architecte exerçant au secteur public constitue un maillon essentiel de la gouvernance territoriale, garant de la qualité architecturale et du développement durable du cadre bâti. Il souligne le rôle stratégique des architectes publics dans la mise en œuvre de ces nouvelles politiques.
Leur mission est de traduire les orientations nationales en projets territoriaux concrets, à travers :
- L’intégration des approches spatiales et paysagères dans les schémas et plans d’aménagement, selon notamment la loi 12-90 relative à l’Urbanisme et ses décrets d’application.
- La coordination des acteurs territoriaux et la mise en cohérence entre les différents programmes sectoriels (infrastructures, habitat, patrimoine, mobilité).
- La promotion d’une approche durable, en intégrant les principes de la Stratégie nationale du développement durable (SNDD) et du Nouveau Modèle de Développement (NMD).
Le CNOA a d’ailleurs retenu comme thématique centrale pour la Journée Nationale de l’Architecte prévue en Janvier 2026, « la synergie entre architectes des secteurs public-privé pour un développement territorial équitable »,
affirmant ainsi la volonté d’articuler l’action publique et l’innovation privée au service des territoires.
A+E // L’élaboration d’un statut adapté figure parmi les priorités du CNOA : quelles avancées concrètes peut-on espérer à court terme pour les architectes du secteur public ?
C.B. : Le constat est largement reconnu : le cadre actuel ne reflète plus la réalité du métier ni les exigences contemporaines de l’action publique. Les architectes du secteur public, assument des missions à forte valeur ajoutée : encadrement des politiques urbaines, suivi de la qualité des projets, accompagnement des maîtres d’ouvrage, expertise réglementaire, ou encore valorisation du patrimoine bâti. Pourtant, leur statut administratif et leur progression de carrière restent alignés sur des logiques souvent éloignées de la nature intellectuelle et stratégique de leur fonction.
La réflexion autour d’un statut spécifique de l’architecte du secteur public constitue l’un des chantiers prioritaires du CNOA. La réflexion a été d’ores et déjà entamée avec le corps des ingénieurs pour améliorer le statut interministériel les regroupant et lors de la réunion du 13 septembre, une sous-commission “Cadre réglementaire et statut” a été mandatée pour approfondir le diagnostic des statuts actuels et proposer un texte réglementaire plus adapté aux conjonctures actuelles.
Le statut devrait revaloriser les grilles de carrière et les échelles indiciaires, pour mieux correspondre au niveau de formation et de responsabilité ; ouvrir des perspectives d’évolution professionnelle vers plus de postes de direction, de coordination et d’expertise stratégique ; encourager la formation continue et la mobilité, afin d’accompagner les mutations liées à la durabilité, au numérique et à la gouvernance territoriale.
Aussi à court terme, plusieurs actions pourraient être engagées :
- La constitution d’un groupe de travail mixte entre le CNOA et le ministère de tutelle (Aménagement du Territoire National, Urbanisme, Habitat et Politique de la Ville), chargé d’élaborer les propositions techniques pour une réforme statutaire cohérente.
- L’élaboration d’un guide des missions de l’architecte exerçant au secteur public, en lien avec ses onctions dans les différents départements et leurs directions centrales, régionales et locales.
A+E // Le forum annuel de l’Architecte du Secteur Public a été évoqué : quelle sera sa vocation et en quoi peut-il devenir une véritable plateforme de dialogue et d’innovation ?
C.B. : Le CNOA a acté la création d’un « Forum annuel des Architectes du Secteur Public », à tenir en avril ou mai 2026, conformément aux recommandations des Assises de l’Ordre (juin 2025) et aux décisions de la réunion de Kénitra. Ce forum constituera une plateforme nationale d’échanges sur les spécificités de la pratique architecturale dans le secteur public, et visera à :
- Mettre en valeur les bonnes pratiques et retours d’expérience des architectes publics à travers les régions ;
- Favoriser la coopération interinstitutionnelle entre les ministères, les agences urbaines et les collectivités territoriales ;
- Initier des propositions de réformes réglementaires, notamment sur la gouvernance des marchés publics et les concours d’architecture.
A+E // Comment voyez-vous l’articulation entre le rôle des architectes du secteur public et celui de leurs confrères du secteur privé, dans une logique de complémentarité et de synergie ?
C.B. : Les architectes exerçant dans le secteur public et ceux dans secteur privé, loin de s’opposer constituent les deux piliers d’un même écosystème. Leur complémentarité est indispensable à la qualité du cadre bâti et à la cohérence des politiques d’aménagement.
L’architecte du secteur public, agit en amont et en accompagnement : il participe à la planification, à la régulation, à la programmation et à l’évaluation des projets. L’architecte du secteur privé quant à lui, exerce la maîtrise d’œuvre : il conçoit, coordonne et matérialise les projets dans leur dimension concrète. Ces deux champs d’action, bien que différents, poursuivent la même finalité : produire une architecture responsable, contextualisée et respectueuse de l’intérêt collectif. Les effets d’une collaboration fluide sont immédiats : meilleure compréhension des attentes publiques, processus de sélection plus qualitatif, et projets plus pertinents et durables.
L’architecte du secteur public, par sa connaissance des cadres réglementaires, des orientations territoriales et des enjeux sociaux, peut éclairer les choix du maître d’ouvrage et faciliter le travail de ses confrères libéraux. De sa part, l’architecte praticien, par son approche de terrain, apporte une lecture concrète des besoins et des contraintes, enrichissant la réflexion institutionnelle ; le véritable défi étant la création d’une culture partagée de la qualité architecturale.
Cette synergie, lorsqu’elle est reconnue et organisée, devient un puissant levier pour élever la qualité architecturale au Maroc, renforcer la cohérence territoriale et affirmer le rôle culturel et citoyen de l’architecture dans la transformation du pays.