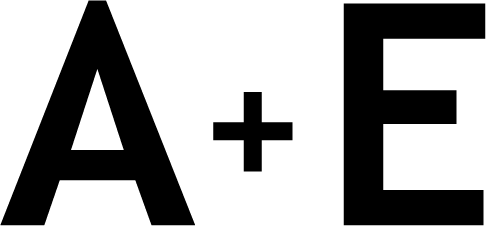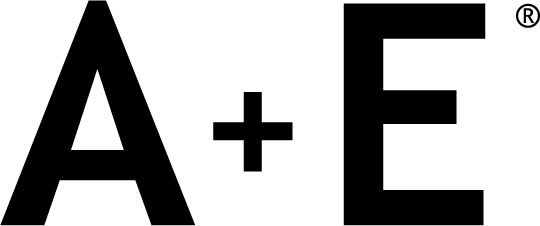Née à Tanger, Nadya Rouizem Labied, architecte et Docteure en Aménagement de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Sa thèse a été lauréate de la bourse de la Caisse des Dépôts pour la recherche en architecture en 2019, et distinguée par une mention de l’Académie d’Architecture à Paris en 2021. Depuis 2020, elle est chercheure associée au laboratoire AHTTEP (Architecture Histoire Techniques Territoire, Patrimoine) à l’UMR AUSSER, ses recherches portent sur les notions de matérialité et d’usage dans l’habitat, notamment en Afrique du Nord. Elle sort à Paris le 4 avril « Réinventer la terre crue » un livre sur l’expérimentation au Maroc depuis 1960 dont elle nous entretien dans cette interview exclusive.

A+E // Quel a été l’élément déclencheur de votre intérêt pour l’architecture de terre ?
N.L : « Après 15 ans de travail en agence d’architecture à Paris, j’ai décidé de m’installer à mon compte, comme architecte libérale, et de poursuivre en parallèle mes études par un Post Master puis une thèse, pour retrouver la dimension réflexive qui manque beaucoup dans notre pratique du métier. C’est la lecture de plusieurs ouvrages sur l’histoire de l’architecture marocaine, champ disciplinaire qui m’intéresse particulièrement en tant que franco-marocaine, que j’ai découvert l’existence de réalisations pionnières modernisant l’emploi de la terre crue à Marrakech et Ouarzazate dès les années 1960. C’est ainsi que j’ai orienté ma recherche vers ce sujet qui m’a tout de suite passionnée, révélant peu à peu l’existence d’autres opérations, grâce à la découverte d’archives inédites ».
A+E // La construction en terre au Maroc existe depuis plus de 10 000 ans. Y a-t-il un corpus qui inventorie et consigne les techniques ?
N.L : « L’architecture vernaculaire en terre au Maroc a fait l’objet de nombreuses publications, surtout à partir du début du XXème siècle. On peut citer l’historien et archéologue, Henri Terrasse, puis l’ethno-sociologue Djinn Jacques Meunié, qui publient des ouvrages sur les constructions en terre du sud. A partir de la fin des années 1970 c’est le CRAterre[1], qui évoque les techniques constructives, notamment le « pisé marocain », dans ses travaux. Plus récemment c’est bien sûr l’architecte et anthropologue Salima Naji qui a aujourd’hui à son actif plusieurs publications sur l’architecture vernaculaire en terre au Maroc, dont la plus récente, parue en 2019, s’appuie sur son expérience dans les chantiers de réhabilitation de l’architecture traditionnelle (Naji, 2019). Tous ces ouvrages montrent que les techniques traditionnelles sont très liées à l’aspect social, économique et culturel, c’est pourquoi la transformation des modes de vie ayant entraîné leur disparition, il faut s’intéresser aussi aux opérations qui réactualisent la construction en terre. Au Maroc, l’architecture savante en terre, c’est-à-dire produite par des maîtres d’œuvre, n’avait pas fait l’objet de travaux spécifiques. Mon ouvrage vient combler ce manque ».
A+E // Dans les années 60, un regain d’intérêt pour l’architecture de terre s’est manifesté par plusieurs expériences. Quelles sont les conditions qui ont favorisé cette émergence ?
N.L : « Le regain d’intérêt pour l’architecture de terre dans les années 1960 fait partie d’une dynamique plus large à l’époque, favorable à l’expérimentation et à l’emploi de matériaux naturels.
On peut d’une part, évoquer la crise du mouvement moderne en architecture dès les années 1950, qui a entraîné la recherche par les architectes de modèles alternatifs, notamment dans les pays du sud. D’autre part, les anciennes colonies ont constitué un laboratoire d’expérimentation pour les maîtres d’œuvre européens : ils ont pu exercer dans des conditions de liberté, en apportant leurs idées et leur expérience, avec l’objectif de s’adapter au contexte. Dans le cas particulier de l’architecture de terre au Maroc, je montre dans mon livre que c’est l’industrialisation du matériau qui a constitué une condition de son acceptation ».
A+E // Et pourquoi tout s’est arrêté soudainement ?
N.L : « Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer cet arrêt et les difficultés rencontrées par les initiateurs de projets en terre par la suite. D’une part, la politique de construction de logements sociaux a changé au début des années 1970, avec la création des ERAC. D’autre part, suite aux évènements politiques, le CERF (Centre d’Expérimentation de Recherche et de Formation) créé en 1967 à la Délégation de l’Habitat, au ministère de l’Intérieur, a été fermé en 1973. C’était ce centre qui avait commencé à poursuivre les expérimentations en terre crue.
Par ailleurs, à l’époque peu d’architectes marocains s’intéressaient à ce matériau. Dans les décennies suivant l’indépendance, l’architecture marocaine a voulu s’inscrire dans le mouvement international, comme en témoigne la reconstruction d’Agadir. Les matériaux naturels, surtout faisant référence au passé, n’étaient pas valorisés.
On peut aussi constater dans les discours des architectes marocains qu’ils ne veulent pas être réduits à leur passé, pour montrer qu’ils sont aussi capables de s’inscrire dans le présent et l’avenir, par des édifices pouvant rivaliser avec l’architecture contemporaine des « starchitectes » ».
A+E // L’expérience de Hassan Fathy à Gourna a été finalement un échec car habiter une maison en terre a été considéré comme un sous-habitat dégradant. Au Maroc avons-nous faits le même constat ?
N.L : « Le village de New Gourna conçu par l’architecte égyptien Hassan Fathy n’a pas été achevé, et les habitants ont refusé de s’y installer, principalement car il les éloignait de leur source de revenus : le pillage des tombes. Je ne pense pas que ce soit réellement le matériau qui a constitué un blocage. D’ailleurs le point de vue égyptien sur le projet a été illustré par un roman de l’écrivain et journaliste Fathi Ghanim (1924-1999), dix ans après la construction du village. Ce premier roman intitulé Al Jabal[2] est une fiction inspirée de la propre expérience de l’écrivain, dans laquelle un fonctionnaire est missionné par le gouvernement pour comprendre pourquoi les villageois refusent de s’installer dans le nouveau village de Gourna construit par l’Etat (Ghanim, 1958). Ce roman, adapté au cinéma, révèle le conflit des habitants avec l’architecte, dû à la distance sociale et culturelle qui les sépare, et surtout leur conflit avec les autorités, qui souhaitent les séparer d’une source de revenus lucrative.
Dans le cas du Maroc, je n’ai pas non plus observé dans ma recherche beaucoup de réticence liée au matériau en lui-même, les bâtiments étaient jugés dans leur ensemble. A Marrakech notamment, la plupart des habitants de l’unité 3 de Daoudiate ont une bonne opinion de leur logement, et de son système constructif. Les critiques adressées à l’époque à l’opération concernaient plutôt l’étroitesse du logement. L’image du matériau dépend beaucoup de sa bonne mise en œuvre de sa valorisation et de son entretien ».
A+E // Faut-il réhabiliter l’habitat en terre dans l’imaginaire collectif avant de le proposer comme mode d’habiter ?
N.L : « Bien sûr, la méconnaissance de la construction en terre représente un frein à son développement. Il faut communiquer plus autour de ce matériau, notamment auprès du grand public.
Au Maroc on ne connaît que l’architecture monumentale en terre des ksours et kasbas, ainsi que l’architecture « ordinaire » en terre, celle des douars ; l’image du matériau est donc associée à des techniques passéistes ou rudimentaires.
On observe pourtant aujourd’hui une relance de la filière terre crue dans le monde, et aussi au Maroc, où des équipements commencent à être construits en terre, comme l’Ecole de jardinage du Bouregreg à Rabat. Il y a une filière qui essaie de se mettre en place, autour de laquelle il faut communiquer. Les évènements autour de la terre, comme les colloques ou les séminaires, restent souvent fréquentés uniquement par un cercle restreint, et concernent la plupart du temps la réhabilitation du patrimoine vernaculaire.
Pour répondre à votre question, je pense qu’il faut effectuer les deux actions simultanément : communiquer autour de l’habitat en terre et le proposer comme mode d’habiter. C’est aussi en construisant des opérations exemplaires, comme celles bâties dans les années 1960, que l’on peut réhabiliter le matériau ».
A+E // Pensez-vous que le retour à la construction en terre soit possible et dans quelles conditions ?
N.L : « Le retour à la construction en terre a déjà été amorcé timidement au Maroc grâce aux actions d’architectes comme Denis Coquard par exemple, qui propose la formation aux différentes techniques. La question de la formation des acteurs du bâtiment est primordiale : étudiants, architectes, entreprises, maallems, maîtres d’ouvrage, etc. La culture du béton est encore trop présente dans les écoles d’architecture, et la crise environnementale et sociale ne sont pas abordées de manière contextuelle.
On voit aujourd’hui dans notre pays se construire des écoquartiers et des maisons écologiques, totalement calqués sur les modèles occidentaux, et présentés en tant que stratégie de développement durable dans le secteur du bâtiment, alors que nous avons une tradition séculaire de construction en terre. Il faut sortir de ce paradoxe.
Mais je pense surtout que la réactualisation de la construction en terre se fera par la commande publique. Ce sont de grandes opérations d’envergure, comme les milliers de logements construits dans les années 1960 en béton de terre stabilisée, qui permettront de relancer la filière terre crue ».


A PROPOS DE L’OUVRAGE

Dans les années suivant son indépendance, l’État marocain répond à la pénurie de logements économiques par l’expérimentation de la construction en terre crue. De grands projets sont réalisés à la périphérie de Marrakech, Ouarzazate et Berkane, par des architectes et ingénieurs français et belges, dont Jean Hensens et Alain Masson. Innovants par leur intégration du volet social et économique, ces ensembles urbains représentent des modèles remarquables de l’industrialisation de la terre crue au Maroc dès les années 1960. L’ouvrage s’appuie sur d’importantes sources archivistiques, souvent inédites, qui font l’objet d’analyse historique, politique et sociale ; il recense les projets construits en terre crue par l’État marocain, s’attachant ainsi à faire apparaître des réponses aux enjeux sociaux et environnementaux actuels.
[1] Centre de Recherche et d’Application de la terre, créé à Grenoble en 1979
[2] Fathi Ghanim, Al Jabal, Dar Ruz al-Yusuf, Le Caire, 1959