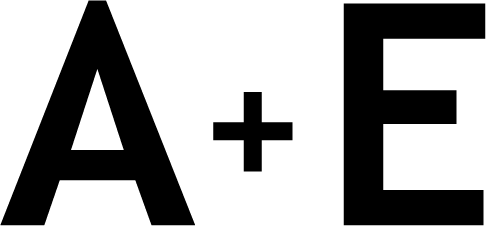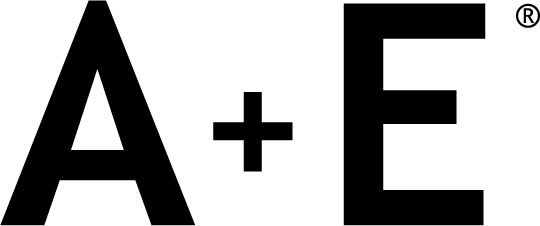Architecte DPLG, diplômée de l’école d’architecture de Paris–La-Villette, Salima Naji exerce son métier d’architecte en explorant les procédés construction ancestraux qu’elle perfectionne et réadapte à des usages contemporains, résolument ancrés dans le développement durable.
A+E // Après votre formation d’architecte, vous avez décidé de faire de l’anthropologie. Pourquoi cette spécialisation ? À quel moment de votre parcours décidez vous de vous spécialiser dans la réhabilitation ?
Salima Naji : Ce n’est pas comme cela que cela s’est passé. On ne trace pas sa voie en choisissant des spécialités dans une grande école aussi prestigieuse soit-elle, mais en construisant une éthique sur la durée. Il m’avait semblé lorsque j’étudiais l’architecture dans cette école très ouverte qui est Paris-La-Villette, que sans avoir des notions d’anthropologie solides, je pouvais difficilement appréhender la complexité des sociétés marocaines, et lorsque l’on m’a accepté à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales – alors installée dans les locaux de la MSH boulevard Raspail entre les vénérables bibliothèques parisiennes et la fondation Cartier pour l’art contemporain dessinée par Jean Nouvel – j’ai pu approfondir beaucoup de pans culturels complémentaires à ma formation initiale artistique. Mais ce qui a été très important pour moi dans mon orientation vers ce que je suis aujourd’hui est le premier voyage que je fis au Mali en 1995.
A+E // En quoi l’Afrique profonde a-t-elle influé votre parcours ?
S.N : La terre crue est en tain de mourir sur les vallées présahariennes que j’étudie en détail à ce moment là dans le cadre d’un troisième cycle en Esthétiques, Sciences et Technologies de l’Image à l’Université de Paris 8, à côté de mes études d’architecture. Au contraire, en pays Dogon, à Ségou, Djenné, Gao, Tombouctou, je fais des photographies, des relevés architecturaux, je rencontre des maîtres d’oeuvre, et je vois alors une vraie vitalité de la terre crue. Pour visiter les mosquées, j’écris – l’arabe et le Maroc sont une clé de Sésame – aux imams des mosquées Mopti et Djenné pour visiter les sites. À Djenné, l’imam me confie à son fils qui me fait rencontrer des maîtres constructeurs. Je loue un vélo et peux alors visiter tous les petits villages en terre de la région. Bref, ce voyage de 40 jours avec des livres et des travaux spécialisés sont une école nouvelle d’apprentissage de ces architectures cousines.
Je pense que c’est cet ensemble de références : l’africanité des architectures de terre, la vitalité de la terre crue ailleurs qui me paraît être un miroir de ce que le Maroc a été naguère, les différentes approches pluridisciplinaires qui se complètent et surtout enfin, comme la synthèse de ce que je vis, la pensée du grand architecte égyptien Hassan Fathy dans son fameux texte « Construire avec le peuple ». Tout ceci m’a donné le goût de l’action, l’envie de réincarner les procédés.
A+E // Vous travaillez sur les architectures des ksours et kasbahs en «immersion» dans les vallées subatlassiques présahariennes depuis… ?
S.N : J’ai entamé mes recherches sur le terrain dès 1992 sur les architectures du Sud marocain des second et troisième cycle en Esthétiques, Arts et Technologies de l’Image à l’Université de Paris VIII (Laboratoire ATI), co-direction Paris, EHESS, anthropologie sociale, et architecture (Ecole d’architecture de Paris-La-Villette) sur l’architecture des oasis (Ziz, Gheris, Tafilalet, vallées du Dadès et du Todgha, Axe Errachidia-Rissani-Alnif-fourche de Nqob-Agdz) ; Vallées du Dra jusqu’à Mhamid Ghizlane et Foum Zguid, (Agdz, Tissergat, Tamnougalt, Zagora, Tamegrout, Nesrat, etc.) ; Vallées du Mgoun, Bou Guemmmez, Ait Oubelli, Tessaout, Magdaz, Imeghrane, palmeraie de Skoura ; Enclave de Figuig… Nourritures spirituelles à portée du regard, à l’époque à l’état de ruines, qui était moins avancé, le béton moins présent qu’aujourd’hui. Ces travaux ont été sanctionnés par mes diplômes et des publications. Ensuite j’ai eu le privilège d’être associée à des sauvetages de lieux emblématiques. Et puis en étant retenue en 2013 dans la sélection de l’un des plus prestigieux prix d’architecture (l’Aga Khan Award for Architecture) pour un ensemble d’actions de fond, notre travail a été reconnu parmi la « short list des nominés ». Cette citation est venue couronner plus de dix ans de chantiers participatifs dans le grand Sud marocain, et plus précisément : la sauvegarde de greniers collectifs et la réhabilitation de Ksours dans des démarches participatives difficiles à mettre en oeuvre.
A+E // C’est à ce moment là de votre vie que vous avez décidé de défendre l’architecture vernaculaire ?
S.N : Cela s’est fait tout seul comme beaucoup de vocations : de retour ici, 10 ans après, quand je suis passée de l’autre côté du miroir dans l’action, je vois bien la disparition programmée de lieux que je connais souvent depuis l’enfance. Des mosquées sont rasées, des horribles maisons énormes en béton sont construites sur ou devant des kasbahs et des greniers, toute cette évolution soit disant « moderne » m’inquiète beaucoup et me pousse à passer à l’action en investissant financièrement sur ces lieux. Cela s’est fait sans calcul, instinctivement, comme le bon sens l’imposait : sauver des sites avec les matériaux locaux et avec les communautés qui les ont mis en oeuvre. Simplement. Les restaurations illégitimes ajoutent des adjuvants polluants de résines ou biocides qui ne respectent pas les sites mais qui semblent très pointues au néophyte. Alors que seul l’apport de pratiques lentes d’un chantier en matériaux locaux comme il se doit, sauve un site sur un très long-terme. Les maçonneries anciennes ne doivent pas être brutalisées.
Il s’est trouvé que cela a été, alors, à contre-courant de tout ce qui se faisait habituellement, mais parce que beaucoup de choses qui se font aujourd’hui sont à l’opposé du bon sens et de la simplicité. On va chercher ailleurs des formules que l’on a sous les yeux . Un complexe de colonisé. Au contraire, ce qui m’intéresse est de réinvestir ce que j’ai glané dans le « vernaculaire ». Il y a une telle richesse, pas seulement en terre crue, en pierres, en techniques mixtes, en bois, etc.
Pour la restauration c’est pareil, j’assiste à l’émoi des villageois, devant une pluie diluvienne qui emporte un pan du vieil Agadir (grenier collectif), vieux de 8 siècles. Je propose que nous le restaurions ensemble. Car je continue à aller visiter vallée par vallée, après les vallées présahariennes bien connues, les flancs atlasiques qui abritent des greniers, tribu par tribu, toujours avec une approche universitaire et l’appui des ouvrages coloniaux sur le sujet, dans le cadre de ma thèse de doctorat sur les greniers collectifs : dans l’Anti-Atlas occidental, chez les Ayt Herbil. Découvrant qu’une somme de quelques dizaine de milliers de dirhams suffira dans un premier temps, je n’hésite pas à casser ma tirelire. Le grenier d’Aguellouy d’Amtoudi est ainsi sauvé sur sa façade Ouest en péril. À l’appel des communautés, chez les Iberkaken, ou encore chez les Ayt Wagharda, et dans bien d’autres lieux où je poursuis mes recherches de longue haleine sur les greniers collectifs, je me mets à leur disposition pour d’autres sauvetages. A Innoumar ensuite, à Igherm, puis à Amtoudi, etc. Cela ne se fait pas toujours, à la dernière minute certaines communautés se rétractent, cela se passe plus ou moins bien. Et lorsque j’ai eu mes distinctions honorifiques (prix d’architecture), je les ai aussitôt reconverties dans l’appui au sauvetage, c’est-à-dire pour payer les maîtres d’oeuvre tandis que je guide la restauration. Le métier d’architecte est un très long apprentissage, je sens ce travail comme une école de la vie…
A côté de ces chantiers de restauration participatifs, je construis des choses plus contemporaines et les allers et retours entre ces deux façons d’exercer mon métier, se nourrissent l’une et l’autre.
A+E // Ce n’est pas évident de restaurer ou de réhabiliter ? Souvent vous privilégiez cela sur la « création » contemporaine ?
S.N : Il y a un sentiment d’urgence qui me pousse à m’impliquer de la sorte et je me le reprocherai toute ma vie si je ne le fais pas maintenant. Partout on bétonne au nom de la « modernité », on rase, on quitte des lieux anciens, on reconstruit sans réfléchir, on densifie, on perd les qualités des espaces pour des lieux affreux où certes il y a moins de poussière, mais où il fait très chaud l’été, très froid l’hiver. Le goût sûr de ces architectures à la beauté austère est remplacé par des décors kitchs très colorés, dans des matériaux exogènes, détachés de leurs origines. Pour les paysages, c’est dramatique.
Mes livres sont le support de cette réflexion au long court. Relever des architectures, en comprendre leur fonctionnement, leur histoire, discuter avec des doyens pour savoir comment les mises en oeuvre se sont faites, les tester et les tester encore, consulter des archives coloniales ou familiales, reconstruire l’histoire de l’institution du grenier collectif ou d’un Ksar mémoriel…
A+E // Vous êtes l’architecte marocaine la plus prolifique en matière d’édition de livres. Comment faites-vous dans un pays dont la moyenne de lecture par habitant est de 6 min par an ?
S.N : Certes. Nos formations dans ce pays sont indigentes, hélas il y a un travail d’éducation populaire à mener. Je le fais sur le terrain dès que je peux, avec les écoles rurales, avec les pouvoirs publics s’ils sont demandeurs. Mes livres sont lus et sont réédités alors qu’ils sont disponibles sur internet aussi. Je crois qu’il y a une cohérence de la démarche, une sincérité et un manque aussi. Je crois que les écoles d’archi – d’après ce que m’ont dit les ENA en France – sont les plus avides. D’ailleurs nous préparons pour l’automne 3 ouvrages qui seront publiés en Europe et qui proposeront une réflexion globale sur mon travail et le patrimoine. En tant qu’architecte et en tant qu’anthropologue, je n’ai jamais cessé d’essayer de sauver cette culture immatérielle.
Une architecture n’est pas seulement une masse construite, elle s’inscrit dans une histoire typologique, ethno-esthétique, elle donne à comprendre des procédés constructifs, elle porte des pratiques matérielles et immatérielles très fragiles, difficiles à sauver.
Les livres répondent à un manque et j’ai chez moi énormément de livres, j’essaie d’avoir des images des monuments depuis des siècles (gravures, plans, lithos, etc.). En cherchant, on trouve beaucoup de choses, on peut reconstruire et justifier ses choix. Ici, presque tout est dans la mémoire orale, rares sont les photographies ou les références imagées. Aussi ce sont souvent des photographies récentes ou des cartes postales qui sont utiles, mais elles sont – quand elles existent – très récentes. La maison de la photographie à Marrakech m’aide, si elle trouve le cliché d’un lieu en cours de restauration et d’autres amis. Souvent les lieux n’ont pas été identifiés et la terre crue retourne à la terre, les modénatures, s’effacent à jamais, d’où aussi mon sentiment d’urgence, la peur de tout perdre à chaque pluie. Or, depuis plus de 20 ans que j’accumule photographies et relevés, enquêtes auprès des artisans constructeurs, j’ai vu tant de «bibliothèques brûler» pour reprendre l’image d’Ambaté Bâ : j’ai vu trop de vieux messieurs disparaître, si vous voulez que je le dise autrement ! Alors, je me hâte, je préfère me consacrer à ces lieux qu’à d’autres commandes plus narcissiques en termes de création que sont la construction contemporaine bien moins contraignante que la restauration de monuments.
A+E // Comment faites-vous pour défendre l’architecture de terre et de pierre auprès de personnes qui pensent que le ciment est le symbole de la modernité ?
S.N : Il y a en effet un paradoxe dans le royaume : la terre a fait ses preuves dans nos territoires historiques, des millénaires durant, mais elle n’est pas formalisée, elle n’est pas certifiée. Elle n’est pas reconnue, pire elle est méprisée, voire crainte car très exigeante. Il faudrait que nous travaillons davantage à la reconnaissance de l’efficacité des techniques traditionnelles. Et il n’y a pas de filières au Maroc : pas de filière d’adobes – nous sommes obligés de tout fabriquer sur les chantiers – pas de briques ou de dallettes de chanvre, on rêverait d’avoir des possibilités de planchers certifiés dans des matériaux naturels.
Mais malgré le plaidoyer dans la presse, les expositions, la communication, et même le sauvetage de tant de sites, nous constatons un autre effritement très inquiétant et concomitant : celui des pratiques constructives. Devant l’urgence que représente le sauvetage d’un ensemble de sites et de leurs pratiques constructives indissociables, nous tentons de nous attaquer à un domaine où l’architecture dite « traditionnelle » est méprisée sinon minorée, en tous les cas rejetée des pratiques constructives tolérées dans le monde normé des marchés publics du royaume.
Depuis plusieurs années, j’ai décidé de perfectionner toutes les techniques vernaculaires en direction de l’architecture contemporaine pour proposer un développement soutenable appuyé sur les Hommes et une fine connaissance des territoires, mais cette fois-ci en direction notamment de projets d’utilité sociale (maternités, centres culturels, foyers féminins, écoles etc.) : pour ainsi essayer de toucher toute la population et réduire l’impact destructeur de l’architecture standardisée actuellement généralisée.
L’idée était de montrer la valeur des technologies ancestrales issues de la terre crue et de la pierre : de montrer la résilience de l’architecture vernaculaire. Y compris dans divers projets sociaux « contemporains » destinés à tous : une maternité en terre, un centre culturel en pierre, des womencenters, etc. (projets INDH et projets d’économie solidaire) inscrits dans le durable et la culture locale. Construire pour les couches favorisées gagnées à cette idée de la terre ou la pierre est finalement plus facile que d’essayer de prendre les choses à bras le corps dans un pays rongé par la corruption.
A+E // En tant qu’architecte « décalée », quel est votre rapport avec l’administration marocaine ? Votre travail a été récompensé par de nombreux prix. Il a été montré en 2015 à l’Institut du Monde Arabe à Paris, seule architecte femme, est-ce que les administrations sont sensibles à votre notoriété ?
S.N : Je dois dire que j’ai rencontré, à chaque fois que l’on m’a permis de le faire, des administrateurs intelligents (ils sont rares mais existent !) et c’est ensemble qu’on a mis au point les CPS pour répondre aux spécifications attendues. Pour moi il a fallu convaincre, écrire les CPS, faire les tests, accompagner l’entreprise ensuite, lui apporter des maalmines s’il le fallait, etc. Et donc ensuite avec des entrepreneurs et des maçons intelligents, on a mis au point tout cela. Désormais avec la Province de Tata nous sommes en train d’essayer de faire un retour sur les réalisations pour toucher les instances de normalisation dans un cadre régional.
Agir est difficile et se fait sur la durée. Les changements de mentalité se font sur 5 ans au minimum et il faut prendre des risques, et il est important de tester, sensibiliser, ajuster, parler et agir en même temps. Avoir une vision et aller jusqu’au bout dans l’intérêt général reste une gageure. Ma démarche patrimoniale du bottom-up – l’approche participative forgée sur ces sites restaurés dans l’Anti-Atlas vient du bas. Preuve que ma méthode, forgée d’abord pour les greniers avec une dizaine d’interlocuteurs, a été transférée avec succès pour la réhabilitation de cet immense Ksar de 7 hectares d’Assa avec plusieurs centaines d’interlocuteurs et peut donner des résultats, si on prend les bonnes décisions et si on adapte les choses intelligemment. Mais il faut des relais, des personnes convaincues. La monétarisation de nos sociétés a détruit les liens ancestraux d’entretien des biens communs. Désormais, ceci est appliqué sur les appels d’offres étatiques pour d’autres projets de sauvegarde de vieux villages avec l’appui de l’Etat, sur plusieurs sites de l’Anti-Atlas. Je suis par ailleurs soutenue par des mécènes privés et des fondations internationales qui se réjouissent des résultats : il est important d’arrêter le rouleau compresseur de la bétonisation et de l’amnésie en cours sur ces magnifiques sites patrimoniaux dont le royaume regorge. Il est encore temps !
A+E // La COP22 est un tournant en 2016. As-tu ressenti son impact en tant qu’architecte ?
S.N : La COP22 a été un moment si bénéfique pour ce type de projets respectueux de leur environnement et de leur histoire. Pour le stand de l’Académie du Royaume, des projets eco-responsables ont été mis en valeur avec des outils et des casques 360° de réalité virtuelle. Un site internet a vu le jour pour diffuser toutes les bonnes pratiques : www.bioclimaroc.ma
La reconnaissance d’une architecture responsable, de qualité, soucieuse des enjeux sociaux, économiques et environnementaux est au coeur de ma démarche. Pour moi, c’est la voie de la sagesse et du bon sens. Et cette voie est plus que possible, elle est nécessaire. Ainsi au village des Ait Ouabelli (province de Tata), situé à proximité d’un lycée et son internat, le projet est celui d’un complexe culturel (bibliothèque, espace multimédia, salle d’exposition, ateliers…) qui a réinvesti les techniques ancestrales en quittant les modèles uniformes, où le béton de ciment n’est qu’une facilité sans réflexion sur le choix des formes. Ce projet d’utilité sociale utilise la pierre en murs porteurs, anoblissant la technique oubliée de la pierre sèche. Contrairement aux idées reçues, le matériau local est évidemment moins cher qu’en ville du fait de son abondance. Travailler les externalités positives en limitant l’apport extérieur au minimum permet de vraies économies d’échelle dans la logique du développement durable. On peut démultiplier les exemples : la maternité en terre crue de Tissint, les womencenters en pierre et adobes n’excluant aucune technique de couverture locale, les complexes scolaires se fondant dans des codes ancestraux de grands porches climatiques, les unités de protection en BTC (blocs de terre comprimée), etc. Faire référence au riche patrimoine des greniers collectifs ou des mosquées de pierre réactive un savoir-faire ancestral affirmé face aux lamentables constructions en parpaings qui envahissent les oasis historiques souvent voisines.
A+E // La promulgation des règles de calcul parasismiques appliquées à l’architecture de terre ont été adoptées. Est-ce que cela a changé quelque chose sur le terrain ?
S.N : Plus de béton, donc moins de place pour la matière grise… Plus d’importance donnée aux bureaux d’études qui tuent le projet s’ils ne jouent pas le jeu de la réflexion avec l’architecte (j’ai la chance de collaborer avec une poignées d’ingénieurs exceptionnels sans doute piqués par le même challenge… Sinon, on obtient des plans avec des poteaux de 0,45, des descentes de poutres épouvantables, des nivellement des terrasses que nous voulions irrégulières, des rabotages en un tout de ciment même quand cela n’est pas utile. Bref, il y a un vrai travail à faire ensemble qui ne doit pas être escamoté et aussi il faut former, accompagner et proposer des alternatives au tout béton. Les gens oublient qu’on se forme toute sa vie et que l’école est juste un passeport pour apprendre… Il faudrait regarder du côté de l’Asie : ils ont du parasismique à base de bois, que je trouve personnellement meilleur que le BA. Malheureusement il n’y a pas de benchmarcking de ce type d’approche peu coûteuse, donc pas intéressantes pour certains. Dommage ! Il faut avoir suffisamment de conviction et d’envie pour son pays aussi. On dit souvent qu’une architecture ratée empoisonne le cadre de vie alors qu’une oeuvre littéraire ou musicale n’aura pas d’impact sur notre quotidien, si elle est ratée… Nous portons une vraie responsabilité pas toujours prise au sérieux.