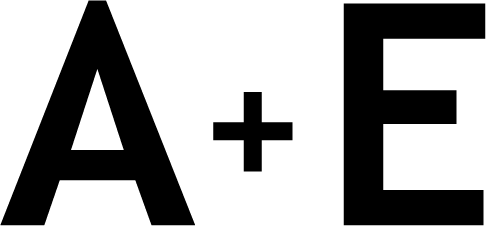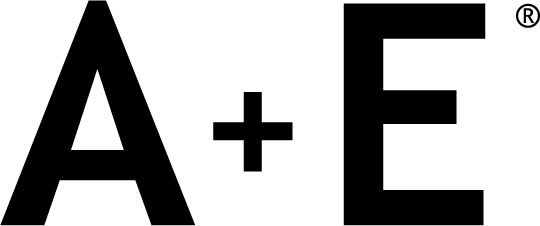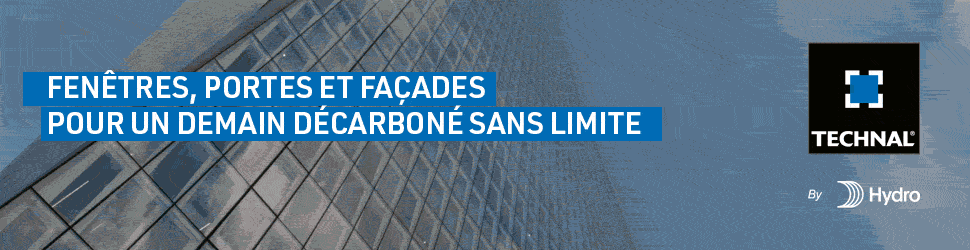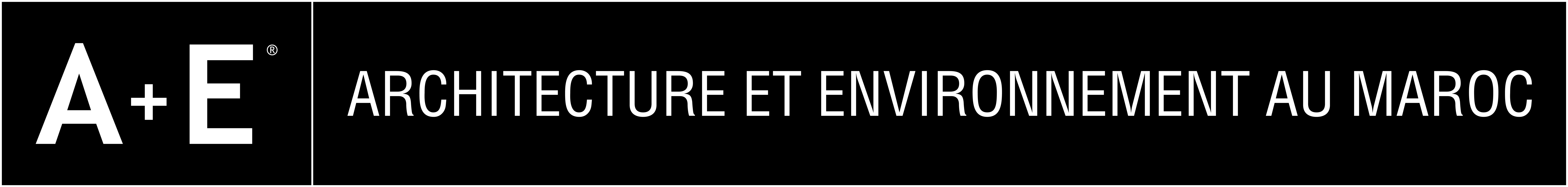Architecte d’intérieur, qualifiée et responsable, Selma Laraqui assiste ses clients dans la définition de leurs besoins et de leurs envies ; elle esquisse et concrétise leurs projets à travers tout le royaume, elle coordonne et dirige les travaux jusqu’à leur réception. Son fonctionnement est assimilable à une construction fondée sur des permutations, sur des inversements d’éléments ou de groupes d’éléments, pour en extraire un sens nouveau, une configuration nouvelle. Son leitmotiv, une citation de Bergson, “Le désordre est un ordre nécessaire”.
“Je sais manger à l’œil” une expression qui signifie consommer gratuitement. “Je peux manger des yeux”, ou regarder avec convoitise, insistance et envie. “J’ai parfois les yeux plus gros que le ventre”, témoignage d’une toute relative mégalomanie ou d’une légère surestime de moi-même.
“L’œil mange”. La problématique sous-jacente consisterait-elle à se demander, comment les architectes pourraient dans leur conception d’un espace de restauration, et ce, par le regard porté par les visiteurs, ouvrir l’appétit à ces derniers ?
L’hégémonie du visuel ? “L’œil mange” et me laisse sceptique.
Il me semble plutôt réducteur (et fort discriminatoire) d’avancer que seuls les yeux mettraient en appétit. Ou même que les yeux mettraient plus en appétit ; ou qu’ils suffiraient à mettre en appétit. “Voir c’est savoir”1 ? Quel visage cette suprématie (de l’œil) prend-elle comme forme en architecture ? Et si la vue sort de l’équation, qu’advient-il du lieu ? N’apparaît-il pas que cette position dominante du regard entraîne un désintérêt, une perte d’acuité, non seulement des autres sens mais du corps dans son ensemble ?
Sauf omission, vous m’accordez que l’appréhension d’un lieu, l’apréhension de mon espace de repas, les volumes pleins ou vides sur mon ventre creux, passent par l’ensemble des sens. Toute expérience de l’architecture qui nous touche est indiscutablement multi sensorielle. Et je pousse plus loin encore, au-delà de mes sens, c’est de tout mon corps que je me nourris.
Il s’agit de mon rapport émotionnel à ce qui m’entoure. Mon rapport autant à l’espace qu’à la matière, qu’à la chaleur, à la lumière, aux sons, aux jeux d’échelles, aux flux, aux seuils, au passage du dedans vers le dehors, à la liberté de déambulation à l’intérieur.
Il s’agit de ma façon de ressentir les transparences, le silence, les odeurs d’humidité, de cuisine, des corps. Le contact des matières, le crissement des verres, le rebondi de la mousse sous la fesse, le grain des sols, leur adhérence aux pas, le frôlement des parois, la cadence des éléments porteurs, le calme ou l’agitation, les mouvements de l’air, l’exposition, le dialogue avec la taille de notre corps, sont autant d’éléments qui participent de manière simultanée à la découverte et à l’appréciation d’un lieu2. C’est ce rapport immédiat au lieu, engageant mon être tout entier qui crée, à mon sens, la qualité architecturale, et par là-même, la compétence de l’architecte.
Posez-vous la question suivante : Qu’est-ce qui m’a touché dans ce restaurant gastronomique, cette pizzeria, ce bar à jus, ce bar à vins, ce snack, ce café, ce salon de thé, cette pâtisserie ?
Laissez-moi vous répondre : Tout, toutes, les choses, les gens, l’air, les bruits, le son, les couleurs, les présences matérielles, les textures, les formes aussi. Et quoi encore? Votre état d’âme, vos sentiments, votre attente d’alors, lorsque vous étiez assis là 3. Ce qui touche dans un lieu n’est pas ce que l’on voit, c’est l’atmosphère de l’espace vécu, dans une temporalité donnée.
“L’œil mange” … Dois-je fermer les yeux pour visualiser mentalement et ramener à ma mémoire un espace parcouru ?
Non, définitivement cette désignation me chiffonne. Comme une crampe à l’estomac. Certes il y a l’atmosphère matérielle, mais l’atmosphère est aussi familiale, professionnelle, culturelle. Autrement dit interpersonnelle, rendant la situation sociale excitante ou déplorable, libératrice, oppressante, inspirante ou parfois sans intérêt.
L’œil, le regard, n’étant pas réflexif 4 , il fabrique une distanciation qui place l’homme d’un côté et l’espace de l’autre. De fait, le centrisme oculaire décrété par le titre est mis à mal, car l’espace n’est pas pour l’homme un vis-à-vis. Lorsque nous entrons dans un espace, l’espace entre en nous, et l’expérience est essentiellement un échange (une fusion ?) entre l’objet et le sujet ; il existe une interaction évidente entre les êtres humains et les choses.
On ne parle finalement que de corps. La rencontre d’un espace, strictement comme avec une autre personne, se fait à partir de l’entièreté de notre être : l’architecture telle qu’appréhendée ici devient elle-même semblable à un corps anatomique.
La rencontre se mue alors en étreinte, avec ses masses et ses membranes et sa matière, ses vibrations, ses tensions. L’atmosphère architecturale suscite en nous cette émotion immédiate, cette compréhension immédiate, ce rejet immédiat. Elle s’adresse à la sensibilité émotionnelle et non à la pensée réfléchie et discursive 5 .
Nous, architectes et architectes d’intérieurs, prenons quantité de décisions qui définissent l’atmosphère d’un lieu et nous le faisons le plus souvent inconsciemment.
Je suis convaincue qu’un bon architecte est celui qui intériorise son projet au point d’en dessiner une situation vécue, pas seulement une ligne sur une feuille. L’architecture quant à elle, si elle s’appuie nécessairement sur la narration biographique du souvenir, doit cependant dépouiller ces images de leur caractère strictement personnel, toujours trop bavard et impropre à laisser le bâtiment être investi par l’usage d’un autre que soi. Dès lors la plupart des choses qui caractérisent l’architecture sont indicibles 6.
Comment alors un architecte peut-il exalter nos sens ? Comment puis-je dire que je me sens bien dans un lieu ? Affiner, à partir de l’architecture, notre relation au monde concret, exige d’identifier, nommer, analyser et comprendre la diversité des canaux sensoriels par lesquels se fondent nos liens aux lieux. C’est ce à quoi sont confrontés les architectes, pour fabriquer l’osmose entre notre état intérieur et ce qui nous entoure. Et la magie opère, créant ainsi ce moment entrelacé où se nouent et se dénouent, dans un mouvement commun, sujet et objet, corps et monde.
C’est alors que la notion d’expérience architecturale est stimulante. Là alors je me sens bien, là je me détends, et là seulement, l’espace me donne le goût des choses, me met potentiellement en appétit.
Paradoxalement, même des bâtiments ou des détails dépourvus de réelle valeur esthétique parviennent à créer une atmosphère sensorielle riche et agréable. Un rien peut tout à fait être consistant, prodigieux, farci d’excès. Un vide peut avoir du corps. Se goinfrer de néant n’est pas chose facile !
“Beauty is in the eye of the beholder7 ”, signifiant que tout est seulement en nous, que chaque esprit individuel est un processus d’interactions avec tout ce qui peut exister en dehors de nous-mêmes, en lien avec notre propre histoire personnelle.