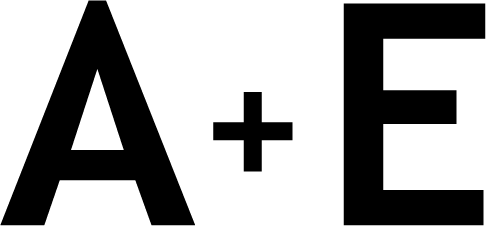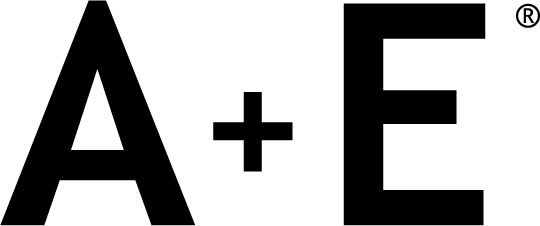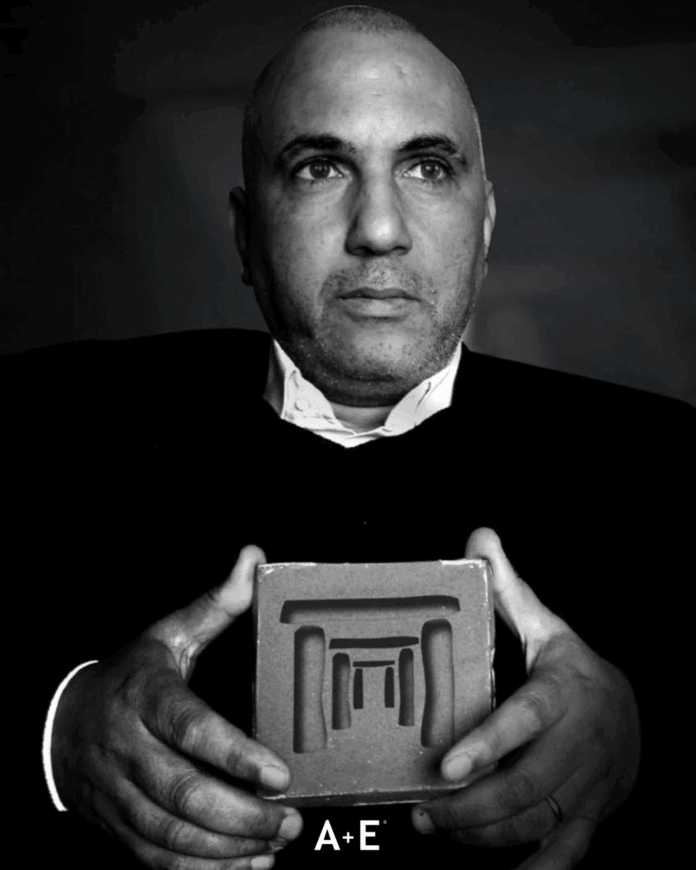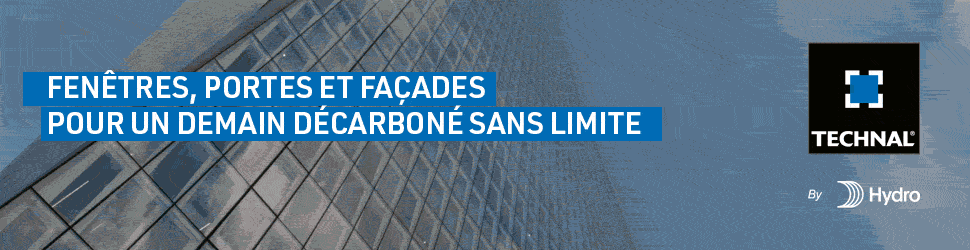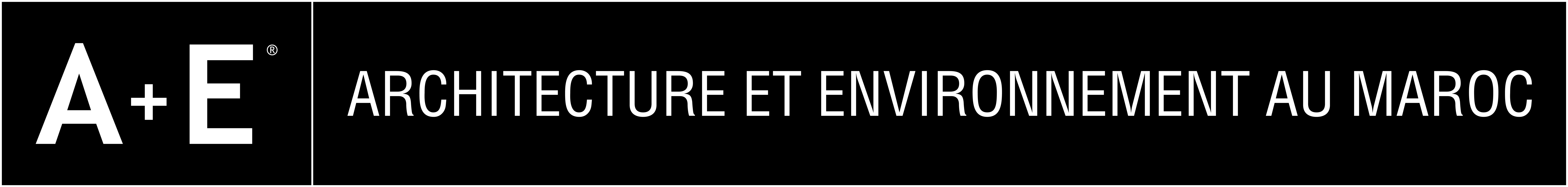Architecte diplômé de l’École d’Architecture de Clermont-Ferrand, Zakaria Boujmal cultive une approche où le minimalisme rencontre la profondeur conceptuelle, où éthique et esthétique se fondent en un dialogue subtil. Fort de plus de vingt ans d’expérience, il œuvre à réinterpréter l’architecture marocaine, en puisant dans ses racines vernaculaires tout en l’ouvrant à l’innovation et aux enjeux contemporains de durabilité.
Ses réalisations, déjà mises en lumière par A+E Magazine, démontre son engagement pour une architecture contextuelle et porteuse de sens. À travers cette interview, Zakaria Boujmal partage avec nous les réflexions qui façonnent son architecture, résolument tournée vers l’avenir.
A+E // En quoi votre formation à Clermont-Ferrand a-t-elle façonné votre regard sur l’architecture et votre manière de concevoir vos projets ?
Zakaria Boujmal : Mon passage par l’École d’Architecture de Clermont-Ferrand reste une expérience fondatrice, presque initiatique, qui a profondément façonné ma vision de l’architecture. L’atmosphère y était particulière, presque mystique, à la manière d’un compagnonnage médiéval. Nous étions formés comme les tailleurs de pierre d’autrefois, avec une approche qui alliait savoir-faire technique, réflexion philosophique et exploration artistique. Ce n’était pas une simple formation académique, mais une immersion dans un monde parallèle où l’architecture devenait une quête de sens, un langage universel capable de transcender les disciplines.
J’ai eu la chance de rencontrer des enseignants visionnaires, dont les paroles continuent de résonner en moi. L’un d’eux nous répétait : « En architecture, l’espace des problèmes n’est pas nécessairement l’espace des solutions. » Cette phrase, d’une finesse désarmante, m’a appris à sortir des cadres établis, à changer de perspective, à chercher les réponses dans l’inattendu. Elle m’a offert une clé pour aborder les défis de manière holistique, un principe que je tente d’appliquer dans mes projets et de transmettre aujourd’hui à mes étudiants.
L’enseignement pluridisciplinaire était au cœur de cette formation. Nous étions exposés à une mosaïque de savoirs : des philosophes qui nous invitaient à réfléchir aux dimensions invisibles de l’espace, des ingénieurs qui expérimentaient la matière, des plasticiens et cinéastes qui nous initiaient à la narration visuelle. Cette diversité m’a appris que l’architecture est bien plus qu’un assemblage de matériaux – elle est un croisement de sensibilité, de techniques et de rêves.
Enfin, cette formation m’a converti à l’architecture dans le sens le plus profond du terme. Elle a éveillé en moi une sensibilité nouvelle, une manière de voir le monde à travers le prisme de l’architecture, de la lumière naturelle, ou encore du temps pour exalter cette magie ou ce sens du sacré que peut revêtir l’acte de construire.
A+E // En quoi votre expérience à la Direction de l’Urbanisme a-t-elle façonné votre regard sur l’architecture et votre manière de concevoir vos projets ?
Z. B. : Mon expérience à la Direction de l’Urbanisme a été courte, mais déterminante. Elle m’a permis d’appréhender l’architecture et l’urbanisme à une échelle très vaste, à la croisée des enjeux politiques, sociaux, culturels, et climatiques. Être exposé aux plus grands projets d’aménagement urbain du pays m’a offert une perspective rare sur la manière dont les choix architecturaux et urbains reflètent, voire façonnent, les valeurs d’une société.
Je garde en mémoire l’exemple du projet d’aménagement de la vallée du Bouregreg, Il aurait été tentant de valoriser rapidement ce territoire stratégique, mais la décision d’attendre, de laisser le projet mûrir jusqu’à ce que les conditions politiques, sociales et économiques soient favorables, a transformé cette initiative en un modèle de mixité sociale et de gestion équilibrée. Cette expérience m’a confirmé que, dans la conception d’espaces, le timing est aussi crucial que le design. Comme dit l’adage ; « Avant l’heure, ce n’est pas l’heure ; après l’heure, ce n’est plus l’heure. »
J’y ai également appris l’art de l’équilibre entre des enjeux souvent conflictuels. Travailler sur des projets qui devaient intégrer des dimensions aussi diverses que le culte religieux, l’éducation, ou la santé, m’a appris que l’architecture est bien plus qu’une discipline esthétique. Elle est une fenêtre et un miroir des aspirations collectives, un lieu où s’entrelacent les contradictions et les ambitions d’un peuple.
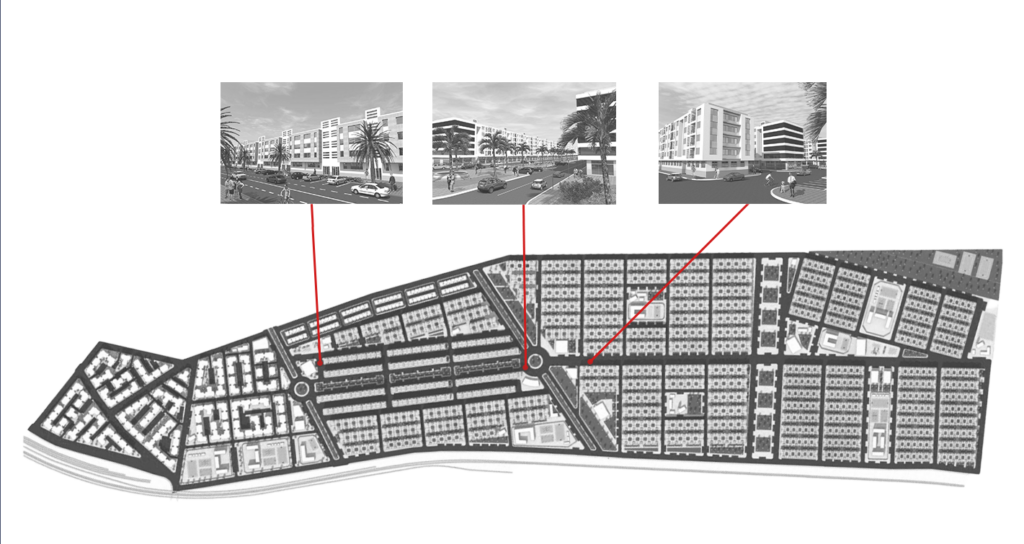
L’image ci-dessus illustre une étude réalisée pour un lotissement de 120 hectares et ses constructions. L’enjeu principal consistait à maîtriser l’articulation entre les échelles architecturales et urbanistiques, tout en intégrant les différentes dimensions et composantes favorisant une urbanité durable.
A+E // Votre spécialisation en architecture du patrimoine a-t-elle modifié votre perception de la réhabilitation et de la transmission des édifices historiques ? Comment intégrez-vous cet héritage dans une démarche contemporaine ?
Z. B. : Ma spécialisation en architecture du patrimoine a profondément transformé ma manière de percevoir les édifices historiques et leur réhabilitation. Elle m’a sensibilisé à une vérité fondamentale : un espace ne devient véritablement un lieu qu’à travers le temps, les vies et les histoires qu’il accueille. Une pièce construite, fermée sur elle-même, reste une abstraction tant qu’elle n’a pas été habitée, vécue, traversée par des instants de vie. Cette prise de conscience m’a appris à respecter l’ancrage temporel des choses, à reconnaître que chaque bâtiment porte en lui les strates du passé et les promesses du futur.
L’architecture patrimoniale est, par essence, un dialogue entre l’espace et le temps. Chaque pierre, chaque fissure raconte une histoire. Réhabiliter un édifice historique, c’est embrasser cet héritage sans le figer. C’est insuffler une nouvelle vie à un lieu tout en préservant l’âme qui le traverse. Je vois cette démarche comme une alchimie subtile entre mémoire et innovation, où le geste contemporain doit être tout aussi respectueux qu’audacieux.
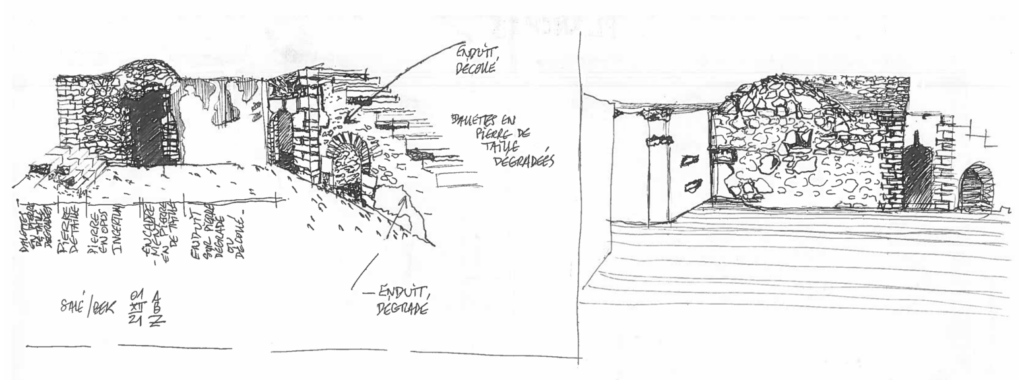
Il y a également cette idée, presque oxymorique, qui m’habite depuis ma formation : la réhabilitation du patrimoine me donne l’impression de lutter contre la finitude des choses. Elle offre une manière de défier l’inéluctable passage du temps, de capturer des fragments d’éternité. Lorsque je travaille sur un projet de patrimoine, j’ai le sentiment de m’inscrire dans une continuité, de voyager dans le temps pour faire résonner les voix

En pratique, cette démarche contemporaine se traduit par une attention accrue aux détails, souvent imperceptibles, mais porteurs de sens. Ces éléments que nous pourrions autrefois juger insignifiants – une corniche érodée, un motif usé – deviennent des témoins silencieux de ce lien fusionnel entre l’espace et le temps. Dans mes projets, je m’efforce de faire dialoguer ces détails avec les besoins actuels, en créant des espaces qui honorent l’héritage tout en accueillant la vie moderne.
Au final, intégrer l’héritage patrimonial dans une architecture contemporaine, c’est reconnaître que le passé et le présent ne s’opposent pas, mais se nourrissent mutuellement. C’est accepter que chaque bâtiment est un fragment d’une histoire plus grande, une histoire que nous, architectes, avons la responsabilité de prolonger avec sensibilité, intelligence et respect.
A+E // Comment décririez-vous l’évolution de l’architecture au Maroc ces dernières décennies ? Quelles tendances émergent aujourd’hui et comment influencent-elles votre pratique ?
Z. B. : L’évolution de l’architecture au Maroc peut être perçue comme une danse subtile entre continuité et transformation, enracinement et émancipation. Depuis des décennies, elle évolue en parallèle avec les grands changements épistémologiques qui traversent notre société. Tout comme la période coloniale a profondément redéfini nos paradigmes sociaux, culturels et urbains, l’architecture aujourd’hui continue de jouer un double rôle : elle est à la fois le miroir de ces mutations et l’un de leurs moteurs. Elle agit comme cause et conséquence, signe d’émancipation tout en étant l’instrument de cette émancipation.
Une tendance marquante de ces dernières décennies est le syncrétisme qui caractérise l’architecture marocaine contemporaine. Il ne s’agit pas simplement d’une juxtaposition entre tradition et modernité, mais d’un véritable dialogue. D’un côté, il y a une projection audacieuse vers l’avenir, portée par des innovations architecturales et des aspirations mondialisées. De l’autre, il y a un ancrage solide dans le patrimoine, une volonté de revisiter et de réinterpréter les savoir-faire locaux avec un niveau d’exigence inédit. Cette approche hybride permet au Maroc de s’inscrire dans un mouvement global tout en préservant une identité propre, sans tomber dans le piège d’une confrontation stérile ou d’une simple imitation.


Je considère que, dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de la construction, le Maroc s’est forgé un véritable pôle d’excellence. Il y a un savoir-faire local, une culture transmise de génération en génération, qui a prouvé sa résilience et sa pertinence. Bien sûr, il serait naïf de dire que tout est parfait. Comme l’a si bien exprimé l’un de mes professeurs : « Parfois, il faut savoir apprécier ce à quoi on a échappé. » Le bilan architectural marocain, bien qu’imparfait, témoigne d’une capacité remarquable à relever des défis et à produire des résultats concrets et durables.
Ce qui me frappe aujourd’hui dans l’évolution de l’architecture marocaine, c’est cette tension productive entre héritage et innovation. Les projets modernes doivent composer avec un contexte patrimonial riche, tout en cherchant à répondre aux besoins et aspirations contemporains. De même, revisiter le patrimoine exige une vision tournée vers l’avenir, sans quoi il risque de devenir un simple exercice nostalgique.
L’architecture marocaine actuelle incarne, à mes yeux, une maturité collective. Elle illustre une capacité à naviguer entre le local et le global, à conjuguer les leçons du passé avec les promesses du futur. Cette dynamique me rappelle constamment à quel point l’architecture est un dialogue entre les époques, les savoir-faire, et les visions partagées.
A+E // Face à l’urbanisation rapide et aux enjeux de préservation du patrimoine, quels sont, selon vous, les plus grands défis pour l’architecture marocaine ?
Z. B. : L’architecture et l’urbanisme au Maroc sont confrontés à un défi majeur : savoir identifier et prioriser les urgences tout en gardant une vision à long terme. Agir rapidement face à des crises, comme un tremblement de terre, tout en intégrant les implications sociales, culturelles et patrimoniales, est une tâche complexe qui exige une grande lucidité.
Prenons l’exemple des zones touchées par des catastrophes naturelles. Parler de patrimoine à des populations sinistrées, profondément marquées par le trauma, peut sembler indécent. Pourtant, ces événements posent des questions essentielles sur la manière dont nous considérons notre patrimoine : non seulement comme un marqueur identitaire, mais aussi comme un cadre de vie pour ceux qui le portent, souvent malgré eux. L’enjeu n’est pas de transformer ces personnes en figurants d’un décor patrimonial figé, mais de trouver des solutions qui respectent leur dignité, leurs besoins et leurs aspirations.
Un autre défi réside dans la pression exercée par l’urbanisation rapide et la spéculation immobilière. Ces phénomènes, parfois irréversibles, menacent de faire disparaître des éléments essentiels de notre patrimoine. Lorsqu’un bulldozer rase tout sur son passage, il ne détruit pas seulement des bâtiments, mais aussi des histoires, des cultures et des liens sociaux. C’est pourquoi il est crucial de mettre en place des politiques et des lois qui protègent le patrimoine contre ces pressions, en évitant les dégâts irréparables.
Ce qui est primordial, c’est d’adopter une approche où le patrimoine reste vivant, c’est-à-dire un espace habité, utilisé et transmis. Il ne s’agit pas de le transformer en une vitrine pour satisfaire un regard extérieur, mais de veiller à ce qu’il continue de servir ceux qui y vivent. Cela implique de préserver l’authenticité tout en répondant aux besoins contemporains, sans céder à la tentation d’un modernisme standardisé ou d’une folklorisation excessive.

Enfin, il faut se rappeler que préserver le patrimoine, ce n’est pas simplement sauvegarder des pierres ou des structures. C’est aussi préserver une mémoire collective, une identité partagée, et surtout une capacité à dialoguer avec l’avenir. Face à l’urbanisation galopante, la priorité doit être d’éviter les « coups partis », ces décisions hâtives qui compromettent durablement notre capacité à transmettre ce que nous avons reçu.
« Préserver le patrimoine, ce n’est pas sauvegarder des pierres, c’est préserver une mémoire collective, une identité partagée et une capacité à dialoguer avec l’avenir »
A+E // Pouvez-vous nous partager un projet qui traduit le mieux votre vision, en conciliant innovation, durabilité et respect du contexte local ?
Z. B. : Un projet qui me vient à l’esprit est celui des bureaux à Tamesna. Ce n’est pas seulement un bâtiment, mais une histoire, marquée par des rebondissements et des ajustements qui ont finalement abouti à une issue heureuse. Ce projet m’a permis de naviguer entre des contraintes pratiques et des ambitions conceptuelles, tout en restant ancré dans une vision durable et contextuelle.

Ce qui rend ce projet si particulier, c’est qu’il ne se contente pas de répondre à des besoins immédiats. Le promoteur, avec beaucoup d’audace, a choisi de sortir des schémas classiques en anticipant des besoins futurs. Il a décidé de miser sur l’avenir de cette ville nouvelle, en créant un espace qui accompagnera une communauté professionnelle dynamique. C’est un pari qui allie ambition et respect de l’histoire à écrire pour Tamesna.
Nous avons adopté une approche bioclimatique, en intégrant des solutions simples mais efficaces pour assurer le confort thermique. Par exemple, la végétation caduque joue un rôle essentiel : elle protège du rayonnement solaire en été, tout en permettant à la lumière naturelle de pénétrer en hiver lorsque les feuilles tombent. Cela réduit la nécessité de systèmes énergivores et assure une intégration harmonieuse à l’environnement. L’objectif était de construire un bâtiment qui dialogue avec la nature plutôt que de s’y imposer. Mais au-delà des aspects techniques, ce projet repose sur une conviction forte : un lieu de travail est aussi un lieu de vie. J’ai voulu créer un environnement qui valorise les gens qui y travailleront, qui leur offre un cadre à la fois fonctionnel et inspirant. Chaque détail compte, jusque dans les jardinières, qui deviennent partie intégrante de l’espace et non de simples ornements. L’idée était de penser à une performance globale, où le bien-être des utilisateurs est indissociable de la durabilité environnementale.
Ce projet est aussi un dialogue avec le contexte local. Il ne cherche pas à s’imposer comme un objet isolé, mais à s’insérer dans le tissu urbain de Tamesna, tout en respectant l’identité de cette ville en devenir. C’est une tentative d’équilibre entre les besoins d’aujourd’hui et ceux de demain, entre le local et le global, entre fonctionnalité et esthétique.
Pour moi, ce projet incarne ce que l’architecture devrait toujours être : une réponse sensible et réfléchie, capable d’honorer le passé tout en accueillant le futur. Ce n’est pas simplement bâtir des murs, mais créer des espaces porteurs de sens, pour ceux qui les habitent et pour ceux qui les traversent.
A+E // Dans votre pratique, comment équilibrez-vous les attentes fonctionnelles de vos clients avec votre engagement envers une architecture porteuse de sens et de valeurs ?
Z. B. : Dans ma pratique, j’ai progressivement élaboré une méthode empirique qui repose sur quatre axes fondamentaux : les enjeux, le concept, la stratégie et la matérialité. Ces piliers me permettent de répondre aux attentes fonctionnelles des clients tout en poursuivant mon engagement envers une architecture porteuse de sens et de valeurs.
Les enjeux, tout d’abord, sont essentiels pour déceler les objectifs implicites et invisibles à première vue. Ils révèlent ce qui ne peut être perçu immédiatement, et c’est souvent là que se trouvent les besoins les plus cruciaux. Le concept, ensuite, sert à clarifier non seulement ce que je souhaite créer, mais aussi ce que je veux éviter – une manière de dessiner les contours du projet en négatif.
La stratégie joue un rôle central dans l’élaboration du projet. Elle consiste à intégrer les contingences de la vie et les aléas du futur sans jamais compromettre l’essence du projet. La stratégie, c’est une forme de sagesse, une capacité à rester flexible face aux imprévus tout en gardant une direction claire. Enfin, la matérialité permet de traduire les idées abstraites en choix concrets et adaptés aux contraintes du projet. Elle montre que des concepts comme la beauté ou la solidité peuvent se manifester sous des formes très différentes : une vue cadrée peut se réaliser via une meurtrière ou une baie vitrée, la solidité par du bois ou de la pierre. La matérialité est une régulation des possibles, où chaque décision repose sur des arbitrages fondés. Cette matrice méthodologique me permet d’intégrer les idées et les attentes du client tout en élargissant son champ des possibles. Chaque projet devient un dialogue, où je peux expliquer concrètement les compromis et les conséquences de chaque choix. Par exemple, déplacer une porte peut transformer entièrement la circulation dans un espace, et chaque décision doit être considérée en tenant compte de son impact global.
Cependant, cette approche n’est pas universelle. Tous les clients ne sont pas en phase avec cette manière de travailler, tout comme je ne peux pas répondre à toutes les attentes. Il est crucial que la relation entre l’architecte et le client repose sur une compréhension mutuelle et une confiance partagée.
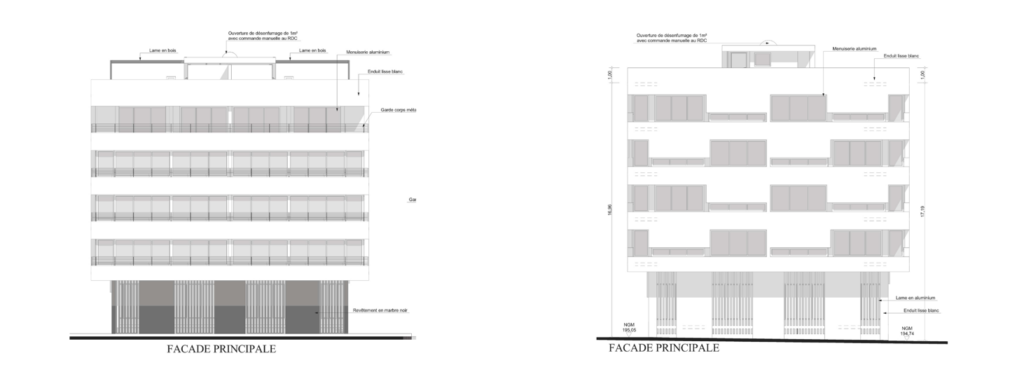
En fin de compte, ma pratique repose sur l’idée que l’architecture est une discipline de régulation des possibles, un cadre qui permet une infinité de solutions tout en restant ancré dans la réalité des contraintes. Ce processus, régi par la matière grise plutôt que par l’argent, est ce qui me passionne le plus dans ce métier.
A+E // Vous citez Luigi Snozzi en soulignant que le projet est un moyen de mieux comprendre la réalité. Comment appliquez-vous cette vision dans votre pratique quotidienne ?
Z. B. : Dans ma pratique quotidienne, je m’efforce d’intégrer une réflexion inspirée de la méthode citée par la sociologue Françoise Navez-Bouchanine, qui met en avant le concept « d’évaluation post-occupationnelle ». Cette approche me permet, en tant qu’architecte, d’observer les bâtiments remplis de vie, fonctionnant et éprouvés par l’usage, afin d’identifier les biais cognitifs auxquels nous pouvons être soumis à notre insu.
Il s’agit de comprendre les besoins réels des utilisateurs, parfois différents de ce que nous imaginons lors de la conception. Les usages qu’ils font de leurs espaces, ainsi que les codes sociaux implicites, parfois indicibles et non verbalisés, révèlent des dimensions inattendues. Cette observation critique et humble enrichit ma compréhension de la réalité, et rejoint la vision de Luigi Snozzi : le projet est un moyen de mieux comprendre la réalité.
En appliquant cette approche, je cherche à réduire l’écart entre l’intention architecturale et l’expérience quotidienne des usagers. Chaque projet devient alors une opportunité d’apprentissage continu, où l’observation et l’analyse des interactions entre les espaces et leurs occupants permettent d’affiner ma pratique et de concevoir des lieux qui répondent mieux aux besoins profonds de ceux qui les habitent.
A+E // L’architecture, pour vous, est-elle davantage un acte artistique, technique, ou philosophique ? Comment équilibrez-vous ces différentes dimensions dans vos projets ?
Z. B. : Pour moi, l’architecture est un équilibre subtil entre l’acte artistique, technique et philosophique. L’architecte est à la fois un philosophe qui construit et un maçon qui philosophe, tout en essayant de créer du symbolique et de la métaphysique. Cet équilibre se manifeste lorsque je ne sais plus si une solution architecturale est une cause ou une conséquence. Ce moment d’ambiguïté, où les frontières deviennent floues, est pour moi le signe que je suis dans l’essence même de l’architecture.
C’est à travers ma méthode en quatre points – enjeux, concept, stratégie, et matérialisation – que j’arrive à naviguer entre ces dimensions. Cette approche me permet de structurer les problématiques et d’offrir des solutions adaptées à chaque projet. Les enjeux posent les bases en définissant ce qui est sous-jacent, le concept cadre les intentions, la stratégie s’occupe des contingences de la vie et du futur, et la matérialisation traduit ces idées en réalité concrète. Cette matrice me donne la liberté d’explorer tout en maintenant une rigueur dans la prise de décision.
Un exemple marquant est celui des jardinières et des fenêtres dans le projet de plateaux bureaux à Tamesna. Je ne sais toujours pas si ce sont les jardinières qui ont façonné le projet, ou si c’est le projet qui a engendré les jardinières. Et je ne tiens surtout pas à le savoir. Ce flou, cette interpénétration entre les éléments, est précisément ce qui confère à l’architecture sa profondeur et sa magie.
Ainsi, l’architecture n’est jamais exclusivement l’un ou l’autre, mais plutôt l’un et l’autre. Elle vit dans cette tension dynamique, où chaque projet devient un espace d’expérimentation, un dialogue entre ces trois dimensions, pour créer quelque chose de porteur de sens.
A+E // En tant qu’enseignant vacataire, quel message ou quelle philosophie souhaitez-vous transmettre aux futurs architectes marocains ?
Z. B. : En tant qu’enseignant vacataire, j’adhère pleinement à cette idée d’André Gide : « Un bon maître a ce souci constant : enseigner à se passer de lui. » Dans ma pratique, j’essaye de partager et de synthétiser mon expérience du terrain, tout en sachant que, sans même en avoir pleinement conscience, mes étudiants m’apprennent probablement autant que je leur transmets. Il s’agit d’un échange réciproque, bien loin d’une relation unidirectionnelle.
L’enseignement, pour moi, est une sorte de préparation physique et mentale – un échauffement intensif, une discipline qui étire et fortifie les esprits pour les réalités du terrain. Cette année, encadrer des étudiants de première année m’a poussé à replonger encore plus profondément dans des questions fondamentales. Avec eux, je redécouvre cette vérité : les évidences ne sont jamais aussi évidentes qu’elles en ont l’air.
Travailler avec ces jeunes esprits me rappelle que des concepts apparemment élémentaires – une porte, une fenêtre, un escalier – peuvent et doivent être revisités sous un nouveau regard. Chaque jour, nous traversons des portes et montons des escaliers sans réellement les interroger. Mon objectif est de les inviter à déconstruire ces objets d’usage quotidien, à développer ce réflexe du « méta », et à redécouvrir la richesse de l’ordinaire. Cette capacité à interroger l’évidence est ce qui rend l’architecture si fascinante. Je leur rappelle – et me rappelle à moi-même – cette maxime essentielle : « Tout ce qui se conçoit bien s’exprime clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. » Si votre idée est claire, vous devriez pouvoir l’expliquer à un enfant de cinq ans. Ce test, simple en apparence, est une référence constante dans ma manière d’enseigner.
A+E // Quels sont vos objectifs ou projets à long terme pour votre agence, en particulier dans un contexte de transformation rapide des espaces urbains au Maroc ?
Z. B. : Mes objectifs à long terme pour l’agence s’inscrivent dans une quête constante ; celle de rechercher et révéler la poésie dans un monde parfois marqué par des perditions et des déperditions. Je cherche à concevoir des espaces qui apportent du bien-être, qui explorent une utopie possible et qui révèlent la beauté sous toutes ses formes. Ces espaces, loin de se limiter à satisfaire des besoins immédiats, tentent de dialoguer avec leur environnement, raconter des histoires et inviter à poser un regard nouveau sur l’ordinaire.
Dans ce Maroc en pleine mutation urbaine, l’enjeu est de préserver l’authenticité tout en évitant que cette transformation ne devienne synonyme de standardisation. Je rêve d’une architecture qui conjugue enracinement et innovation, qui enrichit nos villes en les rendant plus inclusives, adaptées et profondément humaines. J’aspire à des projets qui osent bousculer les conventions tout en respectant les réalités locales. Cette vision, je souhaite la transmettre que ce soit en accompagnant mes clients ou à travers mon atelier d’enseignement, en interrogeant les évidences, en cultivant la curiosité et la résistance à la tentation de copier. En d’autres termes, faire en sorte que persévérer dans le rêve ne soit pas une fuite du réel, mais une façon d’en enrichir les possibles, y insuffler une part de beauté et de sens.
Aujourd’hui, cette démarche prend une nouvelle dimension avec l’appui d’une équipe de création de contenu. Ensemble, nous souhaitons partager une vision de l’architecture, ouverte au dialogue sur ses enjeux et inspirant une réflexion plus large. Ce projet n’est pas seulement un moyen de raconter ce que nous faisons, mais une tentative de démystifier l’architecture, de la repositionner comme un bien commun, un produit accessible et partagé, et un mode d’expression vivant, avec ses hauts, ses bas et ses débats.
En fin de compte, mon objectif est simple ; créer une architecture qui résonne avec ceux qui l’habitent et la traversent, une architecture qui ouvre la voie à un rêve collectif, et qui, à travers ses espaces, invite chacun à réfléchir et à ressentir son imaginaire, et son idéal avec audace et poésie pour le construire à sa mesure.
Propos recueillis par Yasmina Hamdi